Le cinéma d’horreur français ne fait pas recette et reste dans l’ombre de son homologue américain. (Photo : DR)
Adulé quand il vient des États-Unis, le genre est discrédité dès qu’il est « made in France ». Producteurs, distributeurs et exploitants en sont conscients et tentent d’élucider le problème pour donner un nouvel élan au cinéma d’horreur français. En attendant, les réalisateurs hexagonaux composent avec de petits moyens.
Par Romane Boudier, Dah MAGASSA et Esteban PINEL
Le constat est effrayant. Cela fait quatorze ans cette année que Promenons-nous dans les bois, (de Lionel Delplanque), dernier film d’horreur français à succès, attend un successeur. Il a attiré un peu plus de 750 143 spectateurs. Un chiffre qui reste éloigné du top 10 des films du genre les plus vus en France. Neuf fois sur dix, un film d’horreur projeté dans une salle française est américain. Rien qu’en 2014, 13 films venus tout droit de l’autre côté de l’Atlantique sont sortis chez nous, contre un seul français. Ce qui s’explique par l’hégémonie américaine sur le cinéma en général mais pas uniquement. Car, en 2013, ce sont plus de 300 films français qui sont sortis sur nos écrans. Pas loin de un par jour. Rude concurrence.
Mais quand bien même, si les Français produisaient une multitude de films d’horreur, ceux-ci peineraient à faire salle comble. « Ce genre ne peut pas, par définition, être grand public, soutient Denis Mellier, professeur de littérature et de cinéma à l’université de Poitiers. Depuis une quinzaine d’années, ce cinéma est attaché aux thématiques du gore, du trash et de l’hémoglobine à outrance », et cible un public restreint.
Une tradition poétique
« Les cinéastes ont voulu se détacher de la tradition française, plus poétique », souligne Gary Constant, journaliste cinéma pour le magazine culturel tourangeau Parallèle(s) et directeur du festival Mauvais genre à Tours. C’est pourtant cette poésie qui a apporté une certaine crédibilité aux productions d’horreur françaises dans le passé. « Les Yeux sans visage, de Georges Franju, a été considéré comme un objet sérieux, voire intellectuel, par le monde cinéphilique », confirme Laurent Givelet, professeur de cinéma au lycée Balzac, à Tours.

« A l’intérieur », de J. Maury et de A. Bustillo, incarne l’ultragore à la française.
Mais le renouveau du genre en France, qualifié de « néohorreur » par Denis Mellier, a changé la donne au début des années 2000. Ceci en allant à l’encontre de la culture hexagonale. « En France, on regarde la réalité par le filtre des sentiments et de la psychologie, relève Laurent Givelet. Or, aujourd’hui, les films d’horreur ont un rapport beaucoup plus brut avec la réalité. Et ça, on n’aime pas trop. »
Le genre peu accessible donc, avec un défaut supplémentaire : il résiste aux catégories. L’exemple de Promenons-nous dans les bois est à cet égard éloquent. Sur un site grand public comme allociné.fr, il est qualifié d’« épouvante-horreur », mais aussi de « thriller ». Mais c’est lors d’un festival du film fantastique qu’il a été primé. Un mélange des genres qu’on ne retrouve pas outre-Atlantique. « Dans le cinéma hollywoodien, tout est très codifié : un film d’horreur est un film d’horreur » développe Laurent Givelet.
Refroidi par cette confusion du genre, les amateurs du film d’horreur se tournent vers le cinéma américain. Et même lorsque les scénaristes français utilisent les codes du cinéma américain, le public se méfie. Un réalisateur français se lance dans la réalisation d’un « slasher », un sous-genre de film d’horreur dans lequel des adolescents sont poursuivis par un monstre, les spectateurs font la moue. « C’est du cinéma français. Ce n’est qu’une copie du cinéma américain. C’est forcément mauvais… », mime Thomas Pibarot, distributeur pour Le Pacte, une société de production et de distribution (La Horde, la saga Rec…).
Des producteurs trop prudents
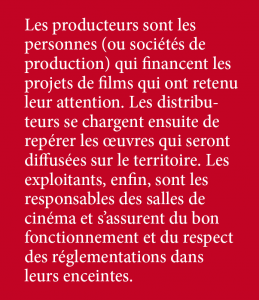 Pour contourner cette idée reçue, des réalisateurs français s’exilent. Ils s’assurent par la même occasion un budget plus conséquent. Alors que le film d’Alexandre Aja Haute tension a généré 110 000 entrées en 2003, avec une production à hauteur de 2,2 millions d’euros, La colline a des yeux, du même réalisateur mais produit par les Américains pour plus de 12 millions d’euros, a dépassé les 500 000 spectateurs en France. Piranhas 3D, autre œuvre franco-américaine du réalisateur, est devenu le film le plus sanglant de l’histoire du cinéma grâce à 300 000 litres de faux sang déversés pour une scène. Une prouesse technique réalisée grâce aux moyens financiers.
Pour contourner cette idée reçue, des réalisateurs français s’exilent. Ils s’assurent par la même occasion un budget plus conséquent. Alors que le film d’Alexandre Aja Haute tension a généré 110 000 entrées en 2003, avec une production à hauteur de 2,2 millions d’euros, La colline a des yeux, du même réalisateur mais produit par les Américains pour plus de 12 millions d’euros, a dépassé les 500 000 spectateurs en France. Piranhas 3D, autre œuvre franco-américaine du réalisateur, est devenu le film le plus sanglant de l’histoire du cinéma grâce à 300 000 litres de faux sang déversés pour une scène. Une prouesse technique réalisée grâce aux moyens financiers.
Les producteurs outre-Atlantique seraient-ils plus performants ? Pour le producteur Richard Grandpierre, cela ne fait aucun doute. Et Florent Bugeau, du réseau de distribution Rezo Films, de confirmer : « Les producteurs français ne savent pas répondre aux attentes du public français en matière de film d’horreur. »
Cette frilosité aurait une raison. Beaucoup de films français sont des échecs commerciaux, comme le récent Aux yeux des vivants, sorti en juillet dernier. « Ça a été une catastrophe industrielle », s’exclame Yann Lebecque, journaliste à L’Écran fantastique, le magazine spécialisé dans ce genre. Ces « flops » incitent les distributeurs à se montrer plus prudents dans le financement de ces projets pas toujours convaincants. Conséquence directe, les réalisateurs ne se bousculent plus pour chercher des financements français. Thomas Pibarot le confirme : « Avant, on recevait une vingtaine de scénarios de films d’horreur. Cette année, aucun. » Le genre se tourne plutôt vers les festivals spécialisés où les films d’horreurs sont très prisés. Sans compter que ce sont des exercices très formateurs dans les écoles de cinéma.
Du côté des exploitants, les réticences sont tout aussi réelles. Les excès de violence de certains films les classent parmi ceux interdits aux moins de 16 voire 18 ans. Ce qui limite d’emblée le nombre de spectateur attendu. Parfois, cette violence déborde de l’écran. Craignant les débordements, les bagarres et les dégradations de sièges, UGC, comme d’autres exploitants, bannissent ces films de leurs salles. Ce, d’ailleurs, quelle que soit leur nationalité. Annabelle, long-métrage de John R. Leonetti sorti début octobre, a engendré tant de désordres parmi les spectateurs adolescents que de nombreux cinémas l’ont déprogrammé.
La télévision en a horreur
Chassé des salles, le film d’horreur à la française n’est pas non plus le bienvenu à la télévision. Il est impassable en « prime time », quand le jeune public n’est généralement pas encore couché (vers 20 h 45). Or les chaînes sont d’importantes sources de financement du cinéma. Elles n’ont qu’un intérêt limité à produire des films qu’elles ne pourront programmer qu’en deuxième, voire en troisième partie de soirée. C’est également le cas des chaînes spécialisées, telle Canal+.

Haute tension, dernier film réalisé en France par Alexandre Aja avant son exil aux Etats-Unis.
Et puis le petit écran a d’autres préférences. « Il porte plus l’effort sur l’achat de séries d’horreur étrangères, comme The Walking Dead », note Laurent Givelet. C’est un marché qui se porte bien et un format qui n’a pas pour contrainte de devoir tenir le haut de l’affiche pour exister. Le public est attentif à cette nouveauté. Par ricochet, des films peuvent en profiter, comme The ABCs of death, un film à sketchs réalisé par des cinéastes indépendants. Il attire les critiques positives et semble convenir tant au public qu’aux spécialistes.
Paradoxalement, c’est tout de même du petit écran que pourrait venir la renaissance. Les séries d’horreur ou de fantastique offrent des pistes de formats et de scénarios que les réalisateurs français seraient susceptibles de suivre. De plus, aujourd’hui, pour pérenniser la diffusion des films, on peut compter sur la VOD (vidéo à la demande). Les films d’horreur français pourraient trouver là leur créneau, sans déranger personne. « Le mieux c’est de regarder le film chez soi devant son écran. La VOD est un outil génial », confirme Alexandre Tristram. le succès de Promenons- nous dans les bois a d’ailleurs connu un second souffle grâce à la VOD. Une réussite qui pourrait inspirer les producteurs.
Pour beaucoup de professionnels du cinéma, les créations actuelles ne sont pas prêtes de retrouver le chemin du succès perdu des années plus tôt. Ils se tournent maintenant vers la jeune génération, plutôt prometteuse, dans l’espoir d’une révélation. Car au delà du problème des scénarios américains ultragores et des producteurs aux compétences douteuses, il serait bon de miser sur des personnalités susceptibles de représenter et de porter le genre. Le film d’horreur français cherche son Danny Boon qui lui permettra de retrouver l’estime des spectateurs.

« Les Yeux sans visage » de Georges Franju était considéré à sa sortie comme un film fantastique. Aujourd’hui, il est classé « épouvante-horreur ».
« Nous devons déjà nous entendre par ce que l’on considère comme un film d’horreur. » Camille Vidal-Naquet, jeune réalisateur, pointe là une des difficultés du genre. Thriller, fantastique, suspense ou encore polar, tous ces qualificatifs peuvent être rattachés au cinéma d’horreur hexagonal. Du coup, c’est compliqué de s’entendre sur ce quoi on parle exactement.
La chose n’est pas récente. Ainsi, un film comme Les Yeux sans visage (1959) de Georges Franju, une référence s’il en est, pouvait entrer dans la catégorie « épouvante-horreur ». Mais aussi dans celle du « drame ». A l’époque, il s’agissait de s’affranchir des « représentations très conventionnelles qu’Hollywood a imposé entre les années trente et les années cinquante », raconte Denis Mellier, professeur de cinéma de l’université de Poitiers. Plus tard, une contre-culture s’est progressivement installée, imposant des scènes « d’un degré de violence et de cruauté dans la représentation de la souffrance et dans le sadisme de la mise en scène jamais vu », insiste l’enseignant. Un phénomène qu’il a analysé dans sa thèse Sur la dépouille des genres. Néohorreur dans le cinéma français.
C’est cette absence de barrières entre les genres qui a amené les réalisateurs à « se rapprocher au plus près de la réalité » dans les scènes de violence, confirme Laurent Givelet, professeur de cinéma au lycée Balzac, à Tours.
Du gore, du trash, et de l’hémoglobine à outrance
Ces passages sanglants ont contaminé d’autres films dits thriller ou action. Que, du coup, on pourrait presque placer parmi des films d’horreur. Ce transfert était pourtant inconcevable il y a encore quelques années. Pourquoi une telle cruauté ? Thomas Pibarot, producteur et distributeur chez Le Pacte, à une théorie : le « syndrome du premier film ». Lorsque Promenons-nous dans les bois a remporté un certain succès, le genre a cru pouvoir se relancer durablement. Les réalisateurs ont alors eu « envie de tout mettre, d’être le plus extrême possible », analyse-t-il.
La deuxième explication avancée l’est par Lionel Delplanque : ces films « utilisent la violence pour déranger le spectateur. C’est une violence assez psychologique », explique-t-il. Caractéristique de cette catégorie, Calvaire (2004), de Fabrice Du Welz, un film qui mélange torture physique et mentale pour brouiller le spectateur.
Thomas Pibarot pointe également le fait que les films français cherchent à se démarquer des Américains et de leur « horreur light, à laquelle tout le monde peut s’identifier ».
Des films français trop américains
Il est pourtant indéniable que nombre de films français s’inspirent largement des codes américains. Yann Lebecque, journaliste de L’Écran fantastique, rappelle que c’est précisément ce cinéma « qui a bercé l’enfance des réalisateurs français ». On retrouve chez ces derniers, par exemple, l’influence des « slasher », ces scénarios où un monstre ou un détraqué tue des adolescents de manière très sanglante. L’influence se remarque aussi dans les décors : « On essaie de placer les films d’horreurs dans des décors qui rappellent des lieux étrangers, en particulier américains. »
La tendance à la violence à outrance ne fait pas l’unanimité auprès du public comme chez certains spécialistes. Alexandre Tristram, fondateur et rédacteur du cinemaclubfr.fr, un blog qui décrypte les films de genre regrette une « américanisation » trop importante qui ne laisse pas de place à une touche française qui a pourtant de quoi être valorisée : « Les réalisateurs français trouvent très souvent de bonnes histoires à raconter. »
Ce qui plaît à Alexandre Tristram : l’élaboration précise du scénario qui s’attarde sur le côté psychologique des personnages. L’horreur n’est donc pas que visuelle. Et Yann Lebecque d’ajouter : « Il y a de bons réalisateurs qui savent écrire, de bons effets spéciaux et des artistes compétents. » Tant de témoignages positifs et porteurs d’espoir qui peuvent laisser espérer voir les films d’horreur français enfin décoller au box-office. Pour cela, se démarquer des Américains et ne plus brouiller les genres semblent être les conditions nécessaires pour imposer une véritable identité et promouvoir un savoir-faire hexagonal que tant de spécialistes vantent.
Pour aller plus loin
Sur la dépouille des genres. Néohorreur dans le cinéma français : Thèse de Denis Mellier
Fan d’épouvante
Le cinéma d’horreur bien de chez nous n’est pas prophète en son pays. L’affirmer est un euphémisme : près de neuf Français sur dix sont incapables de citer le titre d’une œuvre hexagonale*. Par contre, ils vous citeront sans hésiter de nombreuses œuvres débarquées tout droit des Etats-Unis. Certains sondés iront même jusqu’à mentionner ces dernières comme étant françaises. Il y a un océan de notoriété entre les écoles françaises et américaines.
Si le grand public se perd un peu dans la géographie de l’horreur, quelques irréductibles nous ouvrent les portes de cet univers à part. Telle Éléonore Griveau, 21 ans. L’étudiante aux Beaux-Arts à Tours met sa passion pour le genre au service de l’art. Elle nous présente ses créations étranges, ténébreuses. Vous avez dit bizarre ?
« L’horreur est un excellent exercice de style »
Lionel Delplanque, le réalisateur de Promenons-nous dans les bois, sorti en 2000, juge que la culture française n’est pas propice au développement de l’horreur. Le manque de moyens et de spectateurs compliquerait la tâche des réalisateurs.
Des courts métrages, une parenthèse dans l’horreur en passant, un clip du groupe de musique Superbus, le parcours de l’ancien étudiant de l’École supérieure d’études cinématographiques est tortueux. Au milieu de ses nombreux projets, Lionel Delplanque s’est replongé dans les souvenirs de son premier long métrage.
Pourquoi avoir choisi l’horreur pour votre premier long métrage ?
Lionel Delplanque. C’est un excellent exercice de style. Même James Cameron a commencé par cela. Le scénario est généralement très simple. Ce qui compte avant tout, c’est de vouer une passion à la mise en scène. La force d’un film se joue sur le cadrage, le rythme, le son ou encore le jeu d’acteurs… J’avais 28 ans quand j’ai réalisé mon premier long métrage et j’y ai pris un grand plaisir. Mais pour le moment, je ne me vois vraiment pas y revenir. C’est difficile de faire carrière dans ce genre. J’ai d’ailleurs changé de registre avec mon second film, Président (sorti en 2006).

Lionel Delplanque sur le tournage du film de politique-fiction « Président » en 2006, son deuxième long-métrage. Photo : DR
Vous attendiez-vous à ce que le film devienne, dans sa catégorie, le plus vu dans les salles obscures ?
L. D. Il n’était vraiment pas écrit d’avance que ça réussirait. Il y avait un certain scepticisme autour du projet car l’horreur est un genre cinématographique associé au cinéma américain. Mais nous avons voulu nous donner les moyens de faire quelque chose de beau avec un peu plus de 2 millions d’euros de budget. Et, surprise, ça a marché. Le film est sorti dans 40 pays puis s’est bien vendu en vidéo à la demande et à la télévision. Il rapporte même encore de l’argent aujourd’hui.
Pourquoi la réussite du film n’en a pas appelé d’autres ?
L. D. Je pense que la France n’a pas de culture de films d’horreur. La tendance est plus à un cinéma familial, davantage porté sur les drames ou la comédie. Les films interdits au moins de 12 ou 16 ans s’adressent donc à une cible de spectateurs beaucoup plus réduite. Par conséquent, il y a moins de personnes prêtes à investir et à distribuer ces productions. Se lancer dans un film d’horreur aujourd’hui, c’est une grosse prise de risques. Le manque de moyens a des répercussions sur la qualité des films et leur communication. C’est une des différences avec le cinéma américain qui s’appuie beaucoup sur le marketing. Conséquence, les spectateurs en entendent davantage parler et se les recommandent plus via le bouche à oreille.
Les critiques de la presse ne sont pas très flatteuses pour les films français…
L. D. La presse française n’est pas tendre. Elle a été dure avec notre film. En France, et nous en revenons à la question de la culture, les journalistes n’ont pas d’a priori positifs sur les films d’horreur français. Ils sont souvent dans la comparaison. Peut-être trop d’ailleurs. Quand on regarde ce qui se dit à l’étranger, on constate que c’est différent. Pour reprendre l’exemple de Promenons-nous dans les bois, des critiques américains ont écrit tout le bien qu’ils pensaient de la mise en scène. En Espagne, le film a été récompensé du Méliès d’or, prix décerné par la presse, au festival international du film fantastique de Sitges.
Comment le cinéma d’horreur français pourrait-il se relancer ?
L. D. Pour moi, le meilleur moyen serait qu’un de ces films cartonne. Les péplums (qui retracent des épisodes de mythologie antique), par exemple, se sont relancés grâce à Gladiator, alors que c’était devenu un genre ringard. Il faudrait un grand réalisateur aux manettes avec, pourquoi pas, Jean Dujardin dans le rôle principal. Ça pourrait aider… Recueilli par E. P.
L’angoisse à la maison
Pour ceux qui aiment se faire peur tranquillement chez eux, sélection de DVD, de Blu-Ray et de films disponibles en VOD.
Bientôt dans les salles
Le 20 décembre
Catacombes de John Erick Dowdle. Universal Pictures International France. 16,99 euros
A partir du 14 janvier 2015
– L’invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel
– La Dame en Noir : l’Ange de la Mort, de Tom Harper (III)
– A Girl Walks Home Alone At Night, de Ana Lily Amirpour
Dans ce dossier, nous vous avons parlé de
– Promenons-nous dans les bois (2000), de Lionel Delplanque, avec Clotilde Courau, Clément Sibony, Alexia Stresi. Pathé Video. A partir de 2,90 euros. Proposé aussi en coffret avec The Hole, de Nick Ham et Brocéliande, de Doug Headline, Pathé Video, à partir de 49 euros. Disponible en VOD.
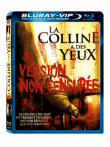 – La colline a des yeux (2006), d’Alexandre Aja, avec Aaron Stanford, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw. 20th Century Fox. A partir de 7,10 euros (DVD), 10,80 euros (Blu-Ray).
– La colline a des yeux (2006), d’Alexandre Aja, avec Aaron Stanford, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw. 20th Century Fox. A partir de 7,10 euros (DVD), 10,80 euros (Blu-Ray).
– Haute Tension (2003), d’Alexandre Aja, avec Cécile de France, Maïwen Le Besco, Philippe Nahon. A partir de 9,45 (DVD. Disponible en VOD.
– Piranhas 3D (2010), d’Alexandre Aja, avec Ving Rhames, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd. Wild Side . A partir de 0,90 euros (DVD), 9,90 euros (Blu-Ray).z
– Les Yeux sans visage (1960), de Georges Franju, Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith scob. Gaumont Classique. A partir de 15 euros (DVD) ou 22,90 (Blu-Ray). Disponible en VOD.
– Calvaire (2004), de de Fabrice Du Welz, avec Laurent Lucas, Jackie Berroyer, Philippe Nahon. Studio Canal. A partir de 10,90 euros (DVD)
– A l’intérieur (2007), Julien Maury et Alexandre Bustillo, avec Béatrice Dalle, Alysson Paradis, Nathalie Roussel. Pathé Video. A partir de 6,18 euros (DVD édition de 2008) et de 13 euros (DVD édition novembre 2014).
 – Annabelle (2014), de John R. Leonetti, avec Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard. Warner Home Video. Coffret à partir de 19,90 euros (DVD), 24,99 (Blue-Ray)
– Annabelle (2014), de John R. Leonetti, avec Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard. Warner Home Video. Coffret à partir de 19,90 euros (DVD), 24,99 (Blue-Ray)
– The ABCs of death (2012), 26 cinéastes proposent 26 courts métrages horrifiques. Optimale. A partir de 14,99 euros (DVD). Disponible en VOD.
 Série
Série
– The Walking Dead (2010), créé par Franck Darabont. Wild Side. Coffret intégrale saisons 1 à 4 à partir de 61,87 euros (DVD), 109,99 (Blu-Ray).

