Semer dans la ville
Des physalis sur le toit d’Agroparistech dans le 5e arrondissement de Paris. Photo Daryl Ramadier/EPJT
Prisée par des citadins en manque de vert, l’agriculture urbaine devient un business lucratif. Concept tendance pour les entreprises à la recherche d’une image verte, enjeu écologique pour les politiques, nouvel objet de recherche pour les scientifiques : la culture en ville intrigue autant qu’elle divise.
Par Emma Gouaille, Noé Poitevin et Daryl Ramadier
L’association La Recyclerie permet à des citadins en manque de vert, comme cette retraitée, de cultiver des salades ou encore des butternuts. La production fournit en partie le restaurant du même nom. Au menu : assiettes pour les locavores – consommateurs de produits locaux et de saison – et cocktails branchés, dans un décor à l’allure de brocante. Un petit paradis vert au milieu du béton francilien, comme il en existe de plus en plus.
Les mains dans la terre
Les adhérents de la Recyclerie se découvrent la main verte. Photo : Daryl Ramadier/EPJT.
Le vendredi, c’est le jour des adhérents. La ferme urbaine, alors inaccessible au public, devient le terrain de jeu de Parisiens convaincus du bien-fondé de l’agriculture urbaine. Guidés par Radj, le jardinier de la ferme, Dominique et les autres bénévoles mettent en terre plusieurs sortes de légumes.
Certains se découvrent un plaisir nouveau : le jardinage. D’autres viennent chercher du vert dans leur cage de béton. Tous veulent retrouver le vrai goût des aliments. « Les urbains sont lassés par les scandales alimentaires, comme celui des œufs au fipronil, explique Christine Aubry, chercheuse à AgroParisTech. Ils veulent connaître l’origine des produits qu’ils mangent. »
La philosophie du mouvement des Incroyables comestibles, né en Angleterre et développé partout en France, est similaire. Loin du productivisme, Sandra Walger, une des adeptes, met en avant la volonté de sensibiliser à une alimentation « différente, plus saine et plus locale, pour recréer du lien social ». L’idée : construire des jardins ou des bacs participatifs dans les villes où chacun peut semer, entretenir et récolter librement. Derrière cette initiative citoyenne, l’ambition de mieux se nourrir tout en (re)créant du circuit court.
La Recyclerie s’attribue aussi et, surtout, une fonction pédagogique. De part et d’autres des allées, le nom des espèces cultivées est indiqué et les méthodes de production sont détaillées au moyen de pancartes colorées et didactiques.
Olivier Fontenas, coordinateur de la ferme urbaine, est là pour veiller au grain. Titulaire d’un master en gestion des sols et services écosystémiques, il multiplie les projets de jardins partagés, comme à la Cité internationale universitaire de Paris. « C’est une ville ancienne avec très peu d’espaces verts, déplore-t-il. Préserver des lieux verts comme notre ferme urbaine, c’est un sacré défi. »
Les 1 000 mètres carrés de la Recyclerie n’ont pas vocation à faire de l’ombre aux agriculteurs existants. « On essaie de faire pousser des choses que d’autres ne font pas ou qui ne se conservent pas. Le but n’est pas de concurrencer les maraîchers extérieurs, de toute façon on n’y arriverait pas. »
L’occasion pour le restaurant de servir des assiettes colorées et originales. À la fin du repas, les déchets sont triés puis redistribués aux poules. Réduire, recycler et réutiliser sont les trois objectifs de la maison. Mais au fond de la cour se dessine une petite serre, où le décor change subitement.
Du high-tech dans nos assiettes
La culture verticale, une des alternatives au manque de terres en ville. Photo : Emma Gouaille/EPJT
CitizenFarm a investi la ferme urbaine de La Recyclerie en y implantant une serre aquaponique (voir infographie ci-dessous). Dans ce temple du végétal, les choux et les salades poussent verticalement sur des étagères. En guise d’ambiance : le son de l’eau qui se déverse dans les bacs et, partout, des prises électriques nécessaires au fonctionnement du système.
Près de 140 mètres carrés de surface et 12 mètres cubes d’eau continuellement en circulation : voilà comment l’entreprise s’essaie à cette autre forme d’agriculture urbaine. Au fond de la serre, un grand rideau abrite de petites pousses. Alimentées par l’eau et la lumière artificielle, elles sortent de terre sous une température réglée avec une précision chirurgicale.
Innovation, production, calibrage. Aujourd’hui, une autre manière de cultiver se profile sous l’impulsion de certaines entreprises. Une image que l’on a plutôt tendance à voir de l’autre côté du globe, où l’agriculture urbaine est déjà à sa phase 2.0. Panasonic ou Fujitsu y ont leurs propres serres et usines.
En Asie, gratte-ciels et villes tentaculaires minent les espaces agricoles. La culture s’y fait en hauteur, comme sur la spectaculaire ferme verticale Sky Green de Singapour, île obligée d’importer 93 % de ses légumes. Au Japon, l’État et les entreprises (Sharp ou Toshiba) boostent la pratique. Baptiste Grard, doctorant à AgroParisTech, constate une « différence culturelle : ils ont un lien à la technologie différent. En France, le grand public a encore une forte relation à la culture pleine terre ».
« Ce n’est pas parce que Xavier Niel met des millions d’euros dedans que c’est un gage de sérieux »
Christine Aubry
Ces équipements s’importent petit à petit en France. La start-up parisienne Agricool, créée en 2015 par deux jeunes diplômés d’une école de commerce, utilise des LED pour faire pousser des fraises. L’entreprise produit notamment dans un conteneur maritime réaménagé – baptisé cooltainer – et installé aux portes du parc de Bercy.
Elle projette d’en installer soixante-quinze autres et a pour cela levé 4 millions d’euros début 2017. Le rendement de fraises annoncé serait cent-vingt fois plus important qu’en pleine terre. Mais la direction n’a pas souhaité nous recevoir et, selon nos confrères de Reporterre, elle fournit elle-même les illustrations de son cooltainer. « On a essayé de collaborer avec des start-ups mais certaines refusent. C’est assez secret », dénonce Christine Aubry sans citer de nom.

Passez la souris sur l’image. Photo : Daryl Ramadier/EPJT
Si l’ambition de verdir l’espace urbain fait consensus, ces nouvelles pratiques divisent. Christine Aubry dénonce un « espèce de délire communicant à coups de mots anglais et de start-up. Nous n’avons pas de données sur la rentabilité économique, sur l’aspect environnemental ni sur l’intérêt nutritionnel des produits. Tant qu’il n’y a pas de recherche publique là-dessus, je considère que cela n’existe pas. Ce n’est pas parce que Xavier Niel met des millions d’euros dedans que c’est un gage de sérieux. »
Pour la chercheuse, il faut avant tout penser à « protéger nos sols, modifier nos styles de production pour les orienter vers l’alimentation de proximité : alors nous ne manquerons pas de terres et n’aurons pas besoin de conteneurs. Il y a des choses à développer, mais cette technologie est surtout utile pour la Nasa », ironise-t-elle.
Un enjeu politique
Plus de 250 exploitations agricoles disparaissent chaque année en France. Photo : Daryl Ramadier/EPJT
Si l’ambition de verdir l’espace urbain fait consensus, ces nouvelles pratiques divisent. Christine Aubry dénonce un « espèce de délire communicant à coups de mots anglais et de start-up. Nous n’avons pas de données sur la rentabilité économique, sur l’aspect environnemental ni sur l’intérêt nutritionnel des produits. Tant qu’il n’y a pas de recherche publique là-dessus, je considère que cela n’existe pas. Ce n’est pas parce que Xavier Niel met des millions d’euros dedans que c’est un gage de sérieux. »
Pour la chercheuse, il faut avant tout penser à « protéger nos sols, modifier nos styles de production pour les orienter vers l’alimentation de proximité : alors nous ne manquerons pas de terres et n’aurons pas besoin de conteneurs. Il y a des choses à développer, mais cette technologie est surtout utile pour la Nasa », ironise-t-elle.
« Quand les grands groupes de distribution font des potagers sur leurs toits, c’est une façon de “green washer” »
Christine Aubry
Paris, où les initiatives se multiplient, souhaite également se faire l’ambassadrice de la culture en ville. Les premiers Trophées de l’agriculture urbaine viennent de rendre leur verdict : six lauréats ont été récompensés, associations (Emmaüs, Veni Verdi…) comme start-up (Aéromate). Centré sur l’agriculture urbaine, le nouvel appel à projets Parisculteurs regroupe divers espaces à cultiver, des terrasses de l’université Panthéon-Sorbonne au toit du Monoprix Bièvre. Porté par la mairie, la charte Objectif 100 hectares entend donner un coup de vert à la capitale.
Là encore, une large diversité de partenaires a répondu présent. Sur la liste des signataires se retrouvent Bouygues Immobilier, Eiffage Construction, Carrefour… De quoi irriter les défenseurs de l’agriculture urbaine, qui pointent du doigt les pratiques de ces entreprises. De la grande distribution qui impose ses prix aux agriculteurs, jusqu’aux constructeurs qui artificialisent les sols.
Cette carte interactive représente les projets d’agriculture urbaine de la saison 1 des Parisculteurs à Paris. La saison 2 sera présentée en juin 2018.
Christine Aubry ne se fait pas d’illusion : « Quand les grands groupes de distribution font des potagers sur leurs toits, c’est une façon de “green washer” (sic) », c’est-à-dire mettre en avant des positions écologiques à des fins marketing.
« C’est clairement pour faire de la communication », appuie un chercheur d’AgroParisTech. Lui regrette le manque de réflexion sur la pratique et comment la rendre durable. « La mairie de Paris a plutôt un objectif politique pour l’instant. Ce n’est pas mauvais en soi, mais elle n’a pas forcément la volonté de cultiver sur les toits pour rendre des services écosystémiques au milieu urbain et assurer sa durabilité. On travaille avec eux mais, pour le moment, il n’y a pas d’objectif environnemental. Peut-être que ça va venir. »
Un exemple parmi d’autres : celui de la bétonisation. « Ces sols ont mis dix mille ans à se former et les bulldozers détruisent tout en quelques secondes, fustige Olivier Fontenas, de la Recyclerie. Une fois qu’ils sont bétonnés, c’est trop tard. »

Davy Cosson, formateur en permaculture, utilise les jardins partagés du parc de la Gloriette à Tours. Photo : Emma Gouaille/EPJT
L’imperméabilisation des sols est « le problème des villes », ajoute Baptiste Grard. Un enjeu pris en compte et étudié à AgroParisTech. Sur le toit expérimental de l’institut, mâche, physalis, fraises poussent dans un sol composite fait de marc de café, de bois broyé et de déchets verts. Plusieurs techniques ont été empruntées aux jardins partagés. Une station météo a été installée pour récupérer des données qui permettent de mesurer l’impact de la pollution sur les aliments – une préoccupation récurrente chez les citadins. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à avoir la main verte.
« Les demandes de jardins partagés sont énormes à Paris et à l’heure actuelle, la mairie est incapable d’y répondre parce qu’il n’y a plus d’espace disponible en ville. » Difficile, même si elles étaient satisfaites, de pouvoir nourrir la ville avec. Sur ce sujet, tous sont unanimes : la question est à écarter du débat. « Il ne faut pas abuser, sourit Davy Cosson, auteur de La Permaculture en ville. On peut produire de la quantité, mais de là à dire que ça nourrira un jour les humains… »
L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) estime qu’il faudrait « 11 000 hectares pour assurer l’autosuffisance en fruits et légumes frais de la population parisienne et 5 000 hectares de plus pour les salariés non-résidents, soit une fois et demi la surface de Paris ». Sans compter les touristes.
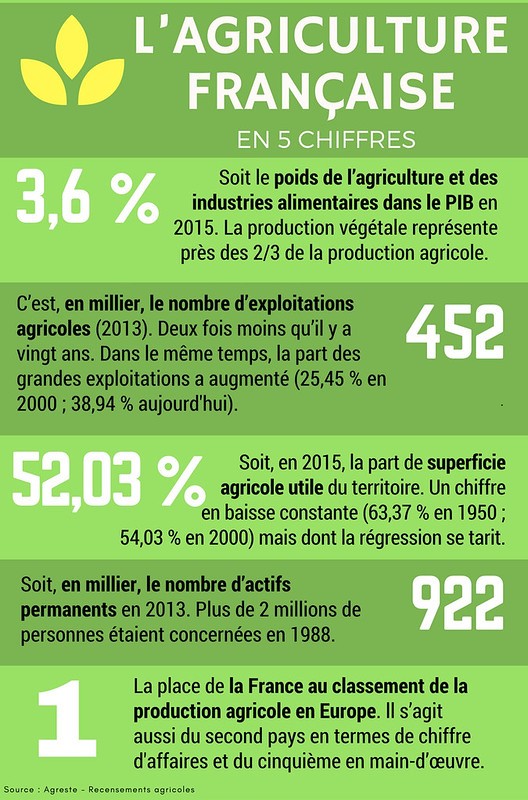
L’agriculture urbaine, en dépit de ses multiples vertus, n’est pas une solution pour l’autosuffisance alimentaire – du moins si elle se limite à la ville. Chaque seconde, la France perd en moyenne 26 mètres carrés de terres. Difficile d’imaginer la culture en ville comme capable d’endiguer ce phénomène, alors que le manque d’espace l’oblige souvent à se replier sur les toits. Face à ce constat, Davy Cosson ne peut retenir un soupir : « La vraie question c’est : quand est-ce qu’on va retourner à la campagne, à la terre ? »

