Montage LC
En vingt ans, l’écoute de musique en ligne a progressivement enterré l’industrie du disque. Parmi les victimes collatérales de ce déclin : la presse musicale. En changeant son contenu et ses pratiques, elle cherche à trouver un nouvel équilibre. Et trouver d’autres voies de financement que le seul journalisme.
Par EPJT
Entre 1990 et 2013, les ventes de magazine culturels ont diminué de 47,2 % si on en croit le rapport annuel du ministère de la Culture et de la Communication. Parmi ces titres, des magazines et revues, hebdomadaires et mensuels, spécialisés dans l’actualité musicale ou la critique.
Une cinquantaine de titres fait heureusement toujours vivre la presse musicale française, souvent spécialisés dans un genre précis tel que le jazz, le rock ou encore le hip hop. Pour survivre et faire face à la crise, ils ont dû s’organiser et se réinventer.
Bousculer sa ligne éditoriale
Capture d’écran
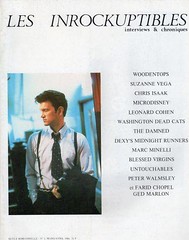
Le premier numéro, avec Chris Isaac en une.
Seule une minorité de ces titres ont gardé un contenu éditorial exclusivement centré sur la musique. Pour les autres, la diversification est une question de survie. L’exemple le plus cité : Les Inrockuptibles. L’hebdomadaire a complètement renouvelé son contenu mais également sa ligne éditoriale. Fondé en 1986 par Christian Fevret et Arnaud Deverre, le magazine est, à l’origine, dédié au rock’n’roll tendance américain et à la pop britannique si on en croit Christian Kaganski. Lors de sa création, son ambition est de faire découvrir chaque mois des artistes méconnus, notamment des Anglais.
En 1995, Les Inrockuptibles passe hebdomadaire. Pour palier la baisse des ventes, le magazine ouvre ses colonnes à d’autres thématiques culturelles : cinéma, littérature, théâtre… Progressivement, il remplace une partie de ses pages consacrées à la musique par des sujets sociétaux, style de vie ou même politiques. En modifiant ainsi sa ligne éditoriale, il réussi à attirer de nouveaux lecteurs et, du coup, de nouveaux annonceurs, notamment des grandes marques du secteur automobile.

Mais si le magazine résiste à la crise, ce sera avant tout grâce à son rachat. En effet, en 2009, le banquier d’affaire, Matthieu Pigasse, acquiert l’hebdomadaire et l’intègre dans son groupe, Les Nouvelles Editions Indépendantes (LNEI) qui compte, entre autres, Radio Nova. L’hebdomadaire empoche également des aides de l’État même s’il ne figure pas en tête des subventionnés. En 2014, Les Inrockuptibles est classé 137e sur 200 au palmarès des journaux et magazines receveurs, derrière, notamment, Le Journal de Mickey qui pointe à la 89e place. C’est cependant le seul titre de presse musicale à figurer dans ce classement.
Nouveau visage, nouveaux titres

Capture d’écran
Si Les Inrockuptibles ont choisi de décaler leur concept, , depuis une dizaine d’années d’autres en explorent de nouveaux, en rupture avec ce qui existe déjà. Et inventent de nouveaux contenus. En 2003, Olivier Drago, crée un magazine exclusivement centré sur le rock, New Noise. Son credo : aborder l’actualité rock, en privilégiant les groupes indépendants. Ainsi, « le bimestriel qui surestime les goûts musicaux des Français », comme l’indique son slogan en couverture, favorise la découverte. L’idée est d’éviter de publier sur les groupes dont la notoriété n’est plus à prouver. « Nos lecteurs ne saisissent pas vraiment notre ligne éditoriale, commente Olivier Drago. L’idée est de parler de scènes rocks moins connues telles que le post-core, le stoner rock ou bien le punk-ska. »
Pour lui, la presse musicale imprimée a encore de beaux jours devant elle malgré la concurrence du Web : « Les pure-players permettent avant tout de suivre l’actualité, les articles de fond sont toujours de meilleure qualité dans un magazine. »
Le lectorat mélomane cherche donc avant tout des titres de la presse musicale privilégiant les longs-formats plutôt que les brèves d’actualité. Partant de ce postulat, le journaliste Samuel Aubert, crée Audimat en 2012. Il veut proposer une revue de critique musicale, avec des dossiers de plus de 70 000 signes. Le ton y est presque académique : chaque dossier ressemble plus à une thèse en musicologie qu’à un article de presse.
Dans les pages d’Audimat, il est possible de trouver des sujets extrêmement spécialisées, tels que « Ethnofiction ou audiovérité, une histoire partiale d’Ocora », « Digitalove : le techno kayō ou la pop japonaise à son pinacle » ou encore « L’ère du glitch : utopie et réification, pour une théorie critique rétrospective ».
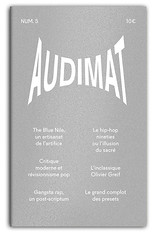
Capture d’écran
Pour Samuel Aubert, le projet est d’écrire librement sur n’importe quelle thématique. « Nous écrivons sur la musique en ne prenant pas en compte les contraintes d‘actualité et les formats de la presse périodique », explique-t-il. Ce format est unique dans la presse musicale : seulement deux numéros sont publiés chaque année. Le concept de la revue se veut en totale opposition avec les formats courts, tel que l’on trouve sur internet. « Il s’agit d’une exigence de qualité vis-à-vis de nous-même et pour nos lecteurs », indique Samuel Aubert.

Etienne Menu, rédacteur en chef d’« Audimat »
Parmi les rédacteurs, des universitaires ou des journalistes, spécialisés dans la critique musicale. Dont Étienne Menu, ancien chroniqueur pour Vice News. Pour lui, Audimat s’adresse avant tout à un lectorat de spécialistes. « La revue est spécialisée, le public est très ciblé. Nous nous adressons avant tout à des nerds, des freaks de la critique », plaisante-t-il. Il réfute le terme « magazine ». Et pour cause, chaque numéro dépasse les 200 pages. Il est impossible de l’acheter en kiosque. Pour se procurer un numéro, il faut se rendre en librairie ou chez certains disquaires qui assurent sa diffusion. Son prix : 10 euros.
« Les rédacteurs d’Audimat « sont des fanzineux, comme des lycéens qui veulent parler de punk dans les années quatre-vingt-dix »
Étienne Menu
Par son format osé, Audimat révolutionne à sa manière la presse musicale. Cependant, il est de plus en plus difficile pour la rédaction de se financer. En effet, n’étant pas considérée comme un organe de presse, la revue ne bénéficie pas de subventions. La seule aide financière provient du Centre national du livre (CNL) et couvre une partie des frais d’impression. « Nous ne sommes pas dans une optique de rentabilité, affirme Étienne Menu. Etant donné la longueur des articles, les rédacteurs gagneraient bien plus dans un autre magazine, si l’équivalent d’Audimat, en termes de format, existait. »
Les rédacteurs ne reçoivent qu’une légère compensation financière pour leur travail. Ils ne cherchent pas à gagner leur vie en collaborant à Audimat. Au contraire, ils rédigent des dossiers musicaux avant tout par passion, tel des « bénévoles de la presse musicale, tel que le rapporte Étienne Menu. Ce sont des “fanzineux”, comme des lycéens qui veulent parler de punk dans les années 1990. »
Les revues et magazines ont redoublé d’effort, d’inventivité et l’offre éditoriale a été renouvelée. Néanmoins, l’ambition de beaucoup de ces titres s’est heurtée à la crise économique que traverse la presse écrite. Tout au long des années deux milles, les titres de presse musicale se sont multipliés. Tous ont une ligne éditoriale unique, souvent basée sur le long-format, et les interviews d’artistes. Vivre de la presse musicale, plus particulièrement en version papier, est devenu très délicat.
Jeux, papeterie, savons, thé, enceintes… on trouve de tout dans la boutique des Inrock. DR.
Afin de trouver un second souffle, certains titres explorent de nouvelles manières de se financer. Notamment en ayant recours au financement participatif sur internet (ou crowdfunding). La rédaction de Gonzaï a tenté l’expérience. Créé en 2007 sur le web par Thomas Ducrès (ou Bester Langs, son pseudonyme d’auteur), ce magazine dédié à la musique électronique est devenu un mensuel imprimé en 2013.
Auparavant, une campagne de financement participatif avait été organisée. Son nom : « Get rich or die trying » (« deviens riche ou meurt en essayant »), en référence au leitmotiv du rappeur américain 50 Cent. « Nous avons eu une bonne surprise, se souvient Thomas Ducrès. Pour un objectif de 8 500 euros, nous avons récolté 10 000 euros, notamment grâce à un don des Inrocks. »

Capture d’écran
Un an après, une deuxième campagne est lancée. Cette fois, Gonzaï récolte 22 000 euros. Le principe : proposer un abonnement à l’année, soit cinq numéros, pour 35 euros de dons via le site de financement participatif Ulule. Par la suite, beaucoup d’autres lecteurs se sont (directement) abonnés via la boutique en ligne du magazine. Afin d’économiser les frais postaux, Thomas Ducrès décide d’éviter les kiosques. « Au début, nous avons développé nos propres réseaux de diffusions, via les librairies et les disquaires afin d’avoir un contrôle total de nos canaux de distribution. »
Pour compléter son budget annuel, Gonzaï consacre également quelques unes de ses pages aux annonceurs publicitaires, mais pas pour tout le monde. Seules les agences de publicité ayant fait un don de 1 000 euros lors de la campagne de financement participatif sont publiées. Pour 2 000 euros de don, le magazine s’engage même à intégrer n’importe quel publi-rédactionnel parmi ses pages.
Gonzaï s’est bien développé. Depuis 2015, il est disponible en kiosque. Mais pour garder l’originalité du concept, chaque numéro coûte « la diabolique somme » de 6 euros et 66 centimes.
Au-delà du journalisme

Capture d’écran
Pour renflouer leurs caisses, les magazines sont toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus. Certains vendent des marchandises en plus de leurs numéros, des goodies. Dans ce domaine, Les Inrockuptibles excelle : entre les hors-séries, les T-shirts ou les coffrets de disques collectors, les produits dérivés se multiplient.
Le magazine organise également des événements à son nom comme, depuis 1990, le festival Les InRocKs. Ce rendez-vous musical se tient chaque année en juillet. L’événement a gagné
en notoriété et rassemble de plus en plus de festivaliers à chaque édition. Cette année, le groupe de rock britannique Radiohead en était la principale tête d’affiche.
Le principe de cette démarche est de se vendre en tant que marque plutôt qu’en tant qu’entreprise de presse. L’hebdomadaire n’est pas le seul à procéder ainsi. De nombreux titres de presse diversifient leurs activités. Tsugi, un mensuel spécialisé dans la musique électronique, rock et hip hop créé en 2007, est un cas d’école. Depuis 2009, il organise des soirées en partenariat avec la salle de concert Le Trabendo, à Paris. Une activité extra-journalistique.
Mutualiser les savoir-faire

Capture d’écran
« La version papier ne rapporte que 40 % du chiffre d’affaire. Il a rapidement fallu créer un site et organiser des soirées pour développer la marque Tsugi », raconte Patrice Bardot, son fondateur. Pour promouvoir, le magazine complète son offre. En marketing, ce concept s’appelle le brand content, le contenu de marque. Il s’agit de proposer une offre sous plusieurs formes, ici : un magazine papier, un site web et des soirées.
Pour Patrice Bardot, la survie de la presse musicale se trouve au carrefour entre le journalisme et la communication. « Aujourd’hui, le journaliste doit-être bi-qualifié, observe-t-il. Il est tellement difficile de se démarquer qu’il faut nous-même se créer du boulot, en couplant
journalisme et marketing. » L’ambition de Patrice Bardot est de continuer à développer la marque Tsugi. D’autres titres ont été créés : Reggae Vibes, magazine sur
la musique jamaïcaine et Serge, spécialisé sur la chanson française. Une webradio est même apparue cette année : radio Tsugi. « Notre objectif est de créer un véritable groupe de presse en mutualisant des savoir-faire, en journalisme et en communication », insiste Patrice Bardot. Et d’ajouter : « La presse est régie par des lois qui datent d’après-guerre. Elles sont complètement dépassées depuis la démocratisation d’internet. Pour tenir Tsugi à flot, il a fallu nous débrouiller en développant de nouvelles stratégies économiques. »
Car pour ce patron de presse, comme pour beaucoup d’autres, l’avenir de la presse magazine passe forcément par la communication.
