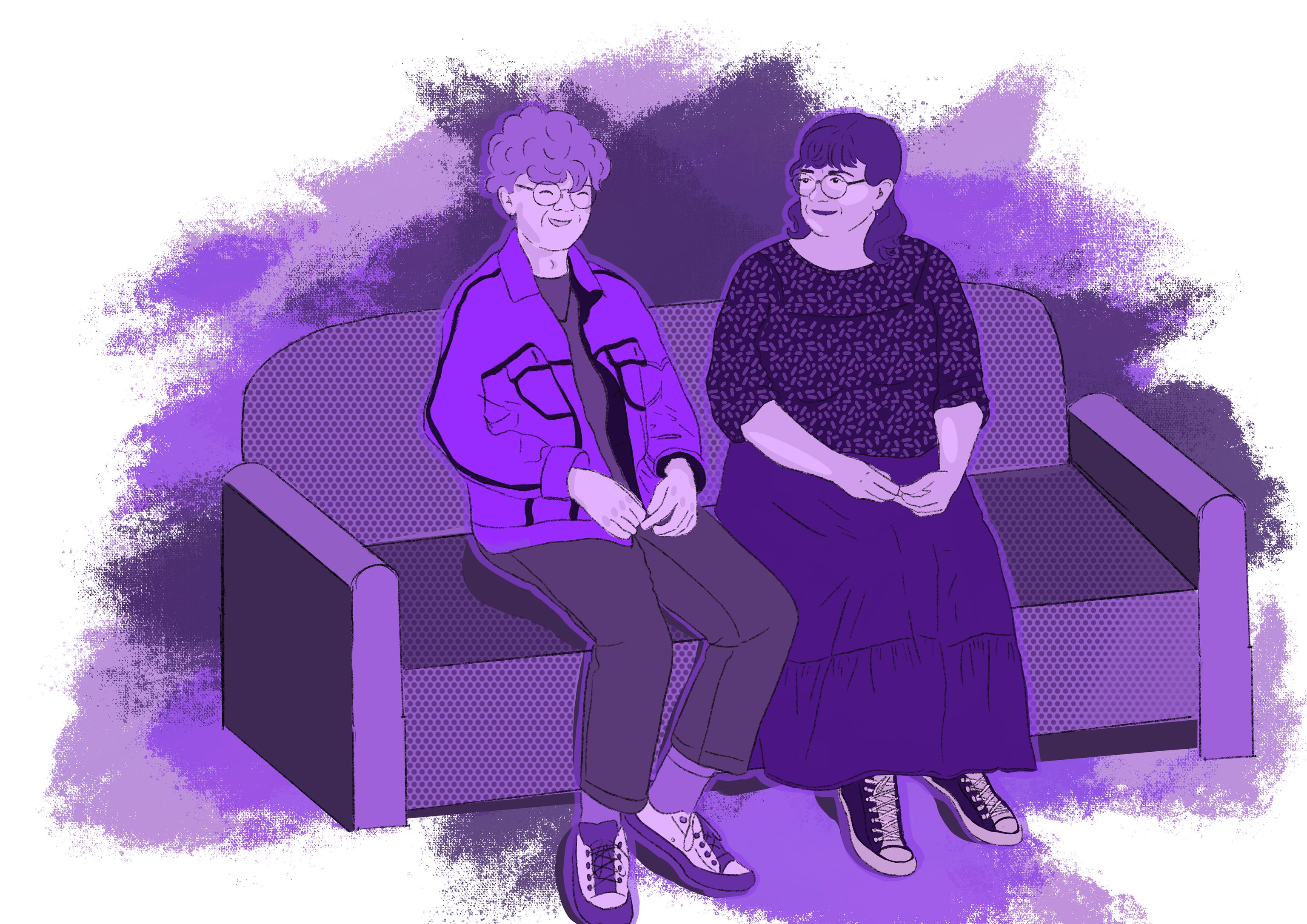En France, débuter une transition médicale pour un mineur est possible mais très difficile d’accès. Même lorsque les enfants sont en situation de détresse, les réticences des parents et des médecins sont nombreuses.
Par Dorali Mensah et Marie Stouvenot
Illustrations : Coline Poiret/EPJT
Je suis une personne inconsciente, délaissée par mes parents et torturée », ironise Ruben. Il reprend, en baissant la tête : « Cette haine-là, elle fait mal parfois. » La peine de Maryse Rizza, sa maman, se lit sur son visage. Ces mots qui blessent, c’est tout ce dont elle veut le protéger. En 2006, à Roubaix, Ruben est né fille, ou du moins, c’est le genre qui lui a été assigné à sa naissance. Mais dès l’âge de 9 ans, il commence à mettre des mots sur son mal-être et en parle à sa mère. Il n’est pas une fille et n’en a jamais été une.
« J’ai dû tout déconstruire, explique Maryse Rizza. Ruben m’a élevée et fait grandir. Moi qui avais l’impression d’être la femme la plus féministe du monde, il m’a appris que j’étais loin du compte… » « Et on est encore loin ! » lâche le jeune homme.
Devenue présidente de l’association Grandir trans, qui regroupe des parents d’enfants transgenres, Maryse Rizza tente d’accompagner au mieux Ruben dans sa transition. Au moment de l’annonce de son fils, la maman avoue qu’elle « a pris une claque phénoménale ».
Un coming-out transidentitaire peut être un choc pour les familles. « C’est toute leur représentation de l’enfant qui s’écroule, affirme Marc Fillatre, pédopsychiatre à la clinique psychiatrique universitaire (CPU) de Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours. Quand pour l’enfant c’est quelque chose qui se reconstruit, pour ses parents c’est souvent tout l’inverse. »
Maryse Rizza a créé une association d’aide aux parents depuis le coming-out trans de son fils Ruben.
Et parfois, ça se passe mal. Très mal. À 300 kilomètres de là, dans un café parisien du 16e arrondissement, une jeune fille de 17 ans se confie. On l’appellera Pauline* : « Mes parents m’ont dit que c’était un projet mortifère. Depuis, je n’ai plus aucun espoir de réconciliation. » Pauline n’est pas un cas isolé. C’est ce qui arrive lorsque le cercle proche, la famille, rejette l’adolescent.
Outre les convictions personnelles des parents, parfois transphobes, ce que ce cercle proche appréhende est l’impact sur son image. C’est bien le regard que porte la société sur les personnes transgenres et la communauté LGBT+ dans son ensemble qui influe, parfois même inconsciemment, sur les parents et fait qu’ils se détournent de leur enfant.
Dans des cas plus graves, un coming-out trans peut mener à la maltraitance. C’est ce qui est arrivé à Isaac*, jeune homme transgenre du même âge que Pauline, rencontré dans une chambre de l’hôpital Saint-Anne, à Paris. Après plusieurs tentatives de suicide, Isaac y a été hospitalisé. « Après que j’ai dit à mes parents que j’étais transgenre, les coups sont devenus très fréquents. Ce n’était plus supportable. » Isaac s’est trouvé dans l’obligation de dénoncer sa mère aux services sociaux pour les violences qu’il a subies. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé en foyer d’accueil.
Son exemple n’est heureusement pas le plus répandu. Mais une idée persiste dans l’esprit de la plupart des parents, voire plus globalement dans celui des adultes. Ceux-ci imaginent que le désir de s’engager dans un processus de transition ne serait finalement qu’une sorte de caprice dû au jeune âge. « Il se cherche » est une phrase fréquemment entendue.

Pauline, une jeune fille transgenre de 17 ans, ne s’entend plus avec ses parents. À l’école, elle a été victime de harcèlement.
Il est en effet commun de voir, dans la transidentité, une simple passade, une crise d’ado. Le Dr Fillatre déconstruit cette idée : « À l’adolescence, effectivement, le jeune doit trouver sa place. Il doit changer de statut au sein de la famille. Pour cela, il va faire un tas de propositions, tester les limites, provoquer. » Mais, poursuit le psychiatre, le processus transidentitaire naît beaucoup plus tôt, à l’âge de 2-3 ans. Il n’est pas détectable immédiatement.
Une partie du corps médical entretient cette confusion auprès des parents. Les enfants n’ont alors plus confiance en ceux qui auraient dû les accompagner. Ils peuvent réagir de façon violente et mettre leur santé en danger. Par ailleurs, ce qu’on appelle la dysphorie de genre peut à elle seule pousser ces enfants à commettre l’irréparable. Et c’est là que l’urgence de prise en charge devrait entrer en ligne de compte.
En dehors du cadre familial, l’école et la société peuvent aussi créer des situations catastrophiques. Pauline a connu une scolarité très difficile, notamment à cause de ses rapports
avec les autres élèves : « On me disait “sale pédé, sale machin”, tout le temps. »
Les choses ont empiré lorsqu’elle est arrivée dans un collège privé catholique du 16e arrondissement de Paris. Ses résultats ont chuté. Elle était harcelée par ses camarades. « On m’a jeté des cailloux, on m’a enfermée dans les toilettes, frappée, menacée. Pourtant, je n’avais même pas fait de coming-out. »
Il lui était impossible de parler de ce qu’elle subissait au personnel scolaire qu’elle jugeait trop strict. Elle craignait qu’il ne se range pas de son côté.
L’école peut accroître le mal-être de certains enfants, notamment ceux de la communauté LBGT+. Une circulaire du ministère de l’Éducation nationale du 29 septembre 2021 donne désormais des lignes directrices à l’ensemble du personnel enseignant.
Plusieurs associations LGBT+ réclamaient que le cadre scolaire soit considéré comme un lieu de sécurité, où les enfants concernés (et surtout les enfants victimes de thérapies de conversion) puissent exprimer leur identité de genre. À ce sujet, la circulaire établit une fiche explicative et encourage au respect de la transition des élèves mineurs.
Sources : Institut Ifop (2018), enquête « Santé LGBTI » Dilcrah (2018) et rapport de l’association SOS Homophobie (2019). Infographie : Marie Stouvenot et Dorali Mensah/EPJT
Dès 2018, l’observatoire LGBTI+ de la Fondation Jean-Jaurès, qui coopère avec la Dilcrah, propose des pistes pour une politique de l’enfance plus respectueuse des personnes de la communauté. Une visait notamment « un libre accès à la santé (y compris, lorsque c’est pertinent, aux éventuels bloqueurs hormonaux) pour les enfants et les jeunes transgenres en particulier » et rappelait que la transidentité n’est pas une maladie mentale.
Pourtant, du côté des médecins, la transition médicale, qui implique la prescription d’hormones masculinisantes ou féminisantes, est discutée. Par manque d’une réglementation stricte, il est difficile de toujours bien répondre à la demande des enfants transgenres.
D’autant plus lorsque leur situation devient urgente et qu’on craint pour leur santé mentale. L’autorité parentale rend impossible toute démarche médicale si elle est uniquement initiée par l’enfant. Le manque de solutions apportées aux mineurs, l’impasse dans laquelle ils peuvent se sentir du fait de leur mal-être, peut les pousser à la dépression, au suicide.
Des médecins radicalement opposés à la transition médicale
Malheureusement, il est souvent compliqué de trouver des médecins qui acceptent de prendre en charge des patients transidentitaires. « Le refus de soins de la part de professionnels, sous prétexte de manque de compétences par exemple, est assez fréquent », explique Anaïs Perrin-Prevelle, coprésidente et secrétaire de l’association militante OUTrans. Tout fonctionne par réseau et par retour d’expérience.
Si certains médecins hésitent, d’autres sont radicalement opposés au processus de transition médicale. C’est le cas de Nicole Athéa, endocrinologue et gynécologue à la retraite, membre de l’observatoire de La Petite Sirène. Un organisme qui a été accusé à de multiples reprises de transphobie.
« Il y a des médecins qui incitent à la médicalisation. Ce sont des idéologues qui veulent absolument voir apparaître une masse de trans qui montrerait combien le concept de genre est une problématique importante, affirme Nicole Athéa. Mais je rappelle que la prise d’hormones médicales comporte des risques, surtout chez les enfants. »
Soit ! Ingérer des hormones n’est pas sans conséquences. De la pilule contraceptive aux tétines de biberon au bisphénol, on met de plus en plus en garde contre les risques qu’elles font courir. Mais il faut savoir faire la part des choses quand les risques de suicide sont élevés.
Lorsque les médecins envisagent une transition médicale, ils imposent un suivi psychiatrique aux adultes comme aux mineurs. C’est également le cas pour les procédure de changement d’état civil. L’idée étant de certifier que la personne n’est pas atteinte de troubles psychiatriques qui viendraient « mimer » une transidentité.
À la fin de l’expertise, qui s’étend sur plusieurs séances, le médecin doit délivrer une attestation indiquant que son patient est effectivement maître de ses décisions et qu’il n’y a pas de contre-indications aux démarches qu’il a entreprises.
Le suivi des mineurs s’effectue dans des unités médicales spécialisées. Comme nous l’avons évoqué précédemment, leur prise en charge n’est pas toujours adaptée, même dans ces unités.
Andrae Thomazo, chercheur en anthropologie à l’université Aix-Marseille, a constaté – durant l’une de ses enquêtes de terrain – que « l’accueil des enfants par ces structures médicales est sensiblement différent de celui des adultes ». Le principe qu’un enfant soit considéré comme malléable pose, là encore, problème. « Ceci induit notamment l’idée de protection et de guérison à son égard du fait de son statut de personne en construction », indique-t-il.
Isaac est un adolescent transgenre de 17 ans. Victime de maltraitance, il a été placé en foyer par l’aide sociale à l’enfance.
Pour l’universitaire, les opinions personnelles des soignants peuvent entrer en ligne de compte lors de la prise en charge même si l’objectif reste son bien-être. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce qu’il y a de mieux pour lui.
Pour ces adolescents, qu’ils soient accompagnés ou non par leurs parents, faire face au corps médical peut donc être une épreuve supplémentaire. « Quand j’ai dit à mon psychiatre que démarrer ma transition médicale était vital pour moi, il ne m’a pas cru, raconte Isaac. C’est toujours le même problème, les médecins ne nous comprennent pas. »
C’est d’ailleurs à cause de ce sentiment d’incompréhension qu’une large partie de la communauté LGBT+ milite aujourd’hui pour une plus grande facilité d’accès aux traitements hormonaux pour les mineurs.
Pas d’hormones sans autorisation parentale
Certains adolescents décident de se procurer des hormones féminisantes ou masculinisantes par leurs propres moyens. Ce qui est illégal. « J’avais besoin de ces hormones, il fallait que je corresponde à l’homme que j’étais dans ma tête, c’était vital. » Pauline, elle, se veut plus prudente. Elle estime que cela peut être dangereux et a donc décidé d’attendre ses 18 ans.
Malgré les dangers que courent les mineurs non soutenus par leur famille, la majeure partie du corps médical refuse de leur prescrire des hormones sans autorisation parentale. Pourtant, la loi le permet et notamment le Code de la santé : « Le médecin […] peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale […] lorsque l’action de prévention, […] le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure. »
Les médecins seraient peu enclins à faire ce choix à cause de « l’angoisse de prendre une mauvaise décision » ou « par peur du procès », commente Andrae Thomazo.
Mila Petkova, avocate au barreau de Paris et spécialiste des questions LGBT+, n’y croit pas : « Le corps médical se cache derrière cette angoisse. Il considère que les enfants ne sont pas des êtres éclairés », accuse-t-elle. Pour l’avocate, le problème est que les enfants sont trop jeunes pour connaître leurs droits. Les procédures devraient être allégées, « comme celles concernant une interruption volontaire de grossesse ».
Celle-ci peut effectivement s’effectuer sans autorisation parentale, à la seule demande de la mineure, qui devra cependant désigner un adulte accompagnant.
À défaut de disposer de consignes strictes, certains médecins, à l’instar du Dr Fillatre, ont mis en place un protocole de prise en charge adapté aux mineurs transgenres. À la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire, le pédopsychiatre propose des thérapies familiales.
La transidentité n’étant pas une pathologie, il estime que le mal-être de ces adolescents émane de leur entourage et/ou de la société. Ainsi, à la différence d’une psychanalyse classique,

Le docteur Fillatre est pédopsychiatre. Il propose des séances de thérapies familiales aux adolescents transgenres dans une clinique près de Tours.
celle qu’il propose permet de travailler avec « tout l’écosystème » du jeune transgenre. « Ce sont des personnes extérieures qui peuvent entraîner la création de réels troubles psychologiques », affirme-t-il. D’où l’importance d’organiser des discussions collectives.
En séance, le Dr Fillatre n’est en aucun cas un médiateur. Son objectif n’est pas d’atteindre l’entente familiale mais plutôt de comprendre l’impact d’une situation sur un individu et ses proches. Surtout, il s’assure que « la personne assise en face de [lui] est saine mentalement ».
Les situations comme celles que connaissent Isaac et Pauline sont parfois inextricables. Pour Maryse Rizza, la maman de Ruben, c’est en train d’évoluer, même s’il « faudrait opérer la déconstruction de tous les codes sur lesquels notre société est fondée ».
Il y a eu d’autres débats qui ont traversé notre pays. C’est le cas notamment du mariage pour tous, de la PMA et, concernant les mineurs, de l’avortement. Celui-ci n’a jamais fait consensus, mais il est tout de même possible sans autorisation parentale. C’est un sujet auquel la société a su faire face malgré les nombreux débats éthiques ou moraux. Il faut espérer qu’il en sera de même pour les mineurs transgenres.
(*) Les prénoms ont été modifiés.

Dorali Mensah
@dorali_m
24 ans.
Journaliste en formation à l’EPJT.
Intéressée par les questions sociales ainsi que les relations internationales.
Passée par Binge Audio, La Nouvelle République et La Provence.
Se destine au journalisme sonore (radio et podcast) ou à la télévision. Alternante au Monde au service podcast.

Marie Stouvenot
@MarieStouvenot
24 ans.
Journaliste en formation à l’EPJT.
Intéressée par les sujets de société, la justice et la santé.
Passée par Corse Matin et Ouest-France.
Se destine au journalisme de presse écrite ou web. Actuellement en alternance à Corse Matin au service web.