L’homoparentalité
une aventure !Dessin anonyme. Tout droit réservé
Si la loi de 2013 sur le mariage pour tous a facilité le chemin des couples homosexuels désireux d’avoir un enfant, leur parcours vers la parentalité reste plus compliqué que pour les personnes de sexe opposé. Récit de l’aventure de ces couples aimants, qui souhaitent, comme les autres, fonder une famille.
Par Lina Bensenouci, Justine Cantrel, Iris Chartreau, Célia Mascré, Camille Sellier

Illustration : Tot’
Voyant leurs amis fonder peu à peu leurs familles, l’idée d’avoir un enfant a commencé à germer. Ainsi que les questions qui vont avec : « Qui le gardera ? », « Où dormira-t-il ? », « Comment paiera-t-on ? ». Si attendre un enfant suscite toujours des interrogations, pour les homosexuels, c’est pire, car bien des obstacles surviennent.

Illustration : Tot’
C'est décidé : on veut un bébé
Illustration : Tot’
« Il a fallu d’abord que l’homosexualité fasse son chemin dans nos vies », confie Rosine, Marseillaise de 35 ans et mère d’une petite fille d’un an et demi. Comme Claire et Léa, elle a eu besoin de temps pour accepter son homosexualité et pour assumer le couple qu’elle forme avec Nathalie depuis huit ans.
Que ce soit devant leurs proches ou leurs voisins, des gestes simples comme se prendre par la main ont mis plusieurs années à devenir naturels. « J’ai dû m’autoriser à vivre mon homosexualité. Quand j’ai enfin réussi, j’ai dû accepter de la vivre publiquement », raconte-t-elle. Aujourd’hui, avec sa fille Julia et sa femme Nathalie, elle assure mener une vie de famille tout à fait classique. Mais il y a « cette étiquette d’homo » dont elle voudrait se débarrasser.
Pour Emmanuel et Sylvain, l’homosexualité n’a jamais été un frein pour avoir un enfant. Ils ont décidé d’avoir recours à une gestation pour autrui aux Etats-Unis.
Même lorsque l’homosexualité est assumée, la décision d’annoncer son désir d’enfant à ses proches ne va pas de soi. Camille et Émilie, en couple depuis cinq ans, ont commencé à s’informer en septembre sur la marche à suivre pour une procréation médicalement assistée (PMA). Elles préfèrent vivre l’aventure seules, de peur de subir la pression de leur entourage. « C’est quelque chose d’intime entre nous », expliquent-elles.
Émilie a 25 ans et est professeure d’anglais. C’est elle qui va porter l’enfant. Si elle tient au secret, c’est que sa propre mère est très protectrice : « Je ne veux pas qu’elle me demande constamment si mes taux d’hormones sont bons », plaisante-t-elle.

Illustration : Tot’
Claire et Léa traînent depuis plusieurs semaines sur des forums de couples homosexuels. À travers les nombreux témoignages, elles mesurent les enjeux de leur désir d’enfant. Elles le savent, ce sera long et compliqué, mais elles sont décidées à aller jusqu’au bout.
« Un couple homo est par définition un couple stérile », note Céline Descriaud, gynécologue-obstétricienne à Saint-Avertin, en Indre-et-Loire. Si les couples hétérosexuels ne se posent que rarement la question du mode de conception, les homosexuels sont obligés d’y réfléchir et de choisir. C’est même une étape importante dans leur cheminement.
Peu de solutions s’offrent à eux pour rester dans la légalité : la relation sexuelle avec un homme ou l’adoption. Mais si cette dernière est autorisée depuis 2013, ce n’est pas forcément le meilleur moyen d’avoir un enfant. « Adopter aujourd’hui est très difficile, peu importe que l’on soit homosexuel ou hétérosexuel », explique une représentante de l’Agence française de l’adoption (AFA). En réalité, pour un couple homosexuel, les chances d’y parvenir sont quasi inexistantes. La raison ? Peu de pays acceptent de confier leurs ressortissants à un couple de même sexe.
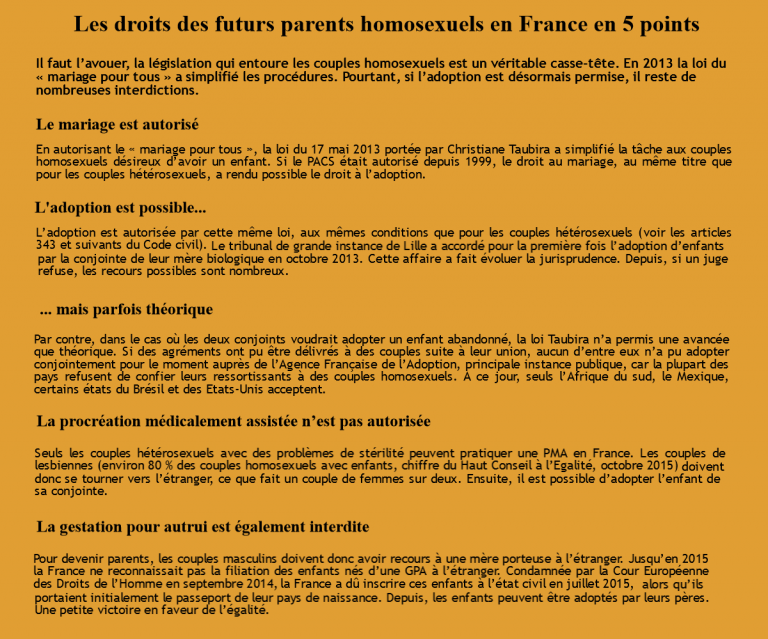
Pour s’y retrouver, les couples se tournent alors vers des associations de défense des droits des homosexuels, comme l’Association de parents gays et lesbiens (APGL). Celle-ci organise régulièrement des réunions d’informations dans ses antennes régionales.
C’est ici que Sylvain et Emmanuel se sont rendus pour parler de leur désir d’enfant et rencontrer d’autres couples avec la même envie. Ou presque : « Il y avait tous les types de profils, comme la coparentalité (avoir un enfant à quatre : un couple de femmes et un couple d’hommes, NDLR). Cette réunion nous a confrontés à ce qu’on ne voulait pas. » Car ce que ces deux-là souhaitent, c’est de « construire une histoire qui [leur] ressemble ». Pour les couples d’hommes, la gestation pour autrui (GPA) s’impose : il leur faut des ovocytes et un corps de femme pour porter l’enfant.
À Claire et Léa, l’APGL a conseillé une PMA. Après leur avoir bien expliqué toutes les réalités qui se cachent derrière ces trois lettres.
Lien filial et lien biologique
Plus elles y pensent, plus Claire et Léa se voient mères. Mais laquelle portera l’enfant ? C’est souvent l’histoire du couple, l’âge, la situation professionnelle ou familiale des futures mères qui le déterminent. Au début, Rosine et Nathalie étaient toutes les deux partantes. Mais « j’avais une volonté beaucoup plus forte d’être enceinte, raconte Rosine qui a eu plus de mal que sa compagne à accepter son homosexualité. Je me sentais plus à l’aise d’être biologiquement la mère, plutôt que d’être ce que l’on appelle le parent social. Je me suis demandée si j’allais réussir à me sentir parent si je ne portais pas l’enfant, si mes propres parents allaient se sentir grands-parents. »
Pour la gynécologue Céline Descriaud, le lien filial devrait être mis sur un pied d’égalité avec le lien biologique, « cela poserait moins de problèmes à la fois pour le géniteur, homo ou hétéro, et pour ceux qui naissent. »
C’est décidé. Léa portera l’enfant. Claire vient d’obtenir un poste à responsabilités qu’elle visait depuis des années. Elle doit faire ses preuves et ne peut refuser cette promotion au risque de compromettre son emploi. Et pour la PMA, elles iront en Belgique. Léa prend son téléphone : rendez-vous dans trois mois.

Illustration : Tot’
Si elles ont choisi ce pays, c’est parce qu’elles veulent que leur enfant puisse avoir la possibilité de connaître son donneur à sa majorité. Ce que ne permet pas la législation espagnole, par exemple. Certaines femmes préfèrent que le donneur soit inconnu. Dans tous les cas, il n’aura aucun droit sur l’enfant.
On se lance
Illustration : Tot’
Avant de s’engager, la plupart des couples souhaitent vérifier le sérieux de l’établissement qu’ils ont choisi. Les associations telles que l’APGL, des forums de parents, ou encore le personnel médical peuvent les orienter : « Notre médecin traitant nous a conseillé d’aller en Belgique parce qu’en Espagne, c’est beaucoup plus commercial. Nous, nous vivons à égale distance. Donc c’est l’intérêt médical qui a primé, puis le coût », explique Adeline, 36 ans, qui s’est mariée avec Marie, 72 ans, quelques mois après la naissance de leur fils Maël, 1 an et demi. Elles ont choisi l’anonymat du donneur de sperme : « Tout ce que l’on sait, c’est qu’il vient du Danemark. »
Adeline n’a reçu que deux inséminations intra-utérines avant de tomber enceinte. Il n’est pas rare de croiser des femmes qui en sont à leur sixième insémination : le taux de réussite dès la première fois oscille entre 12 % et 29 % en fonction de l’âge. Le prix a donc son importance en cas de tentatives multiples. Il faut compter plus de 4 000 euros pour une insémination en Espagne. « En Belgique, on fait payer le prix qu’on ferait payer à une Belge », explique Adeline. Elle a déboursé près de 400 euros par tentative. Ce tarif comprend le don de sperme et l’acte médical. Il faut y ajouter le coût des consultations en Belgique et celui des différents examens préalables à effectuer en France.
PMA/GPA : où sont-elles autorisées ?
En terme de législation, la France figure parmi les mauvais élèves dans le monde. PMA comme GPA sont interdites.
Cliquer sur les pays pour plus d’informations. Dézoomer pour voir plus de pays.
A chaque tentative supplémentaire, les frais engagés s’alourdissent. S’il y a la moindre complication, le recours à une fécondation in vitro (FIV) sera beaucoup plus onéreux. « Nous nous attendions à débourser 600 euros. Et on va devoir dépenser jusqu’à 4 000 euros », se désole Emilie, qui n’est qu’au début du parcours médical. Elle a appris récemment que ses trompes de Fallope étaient bouchées. Elle ne pourra pas avoir recours à une insémination classique. « Je ne vais faire que deux FIV. Et si ça ne fonctionne pas, nous devrons arrêter un moment, le temps de remettre assez d’argent de côté pour réessayer », explique-t-elle, optimiste malgré tout.
En plus des dépenses médicales, les allers-retours en Belgique ont aussi un coût. Sans parler des contraintes d’organisation et du temps passé sur les routes et dans les salles d’examen. « Le plus dur a été de jongler entre une vie professionnelle à temps plein et les besoins médicaux qui nécessitent d’être toujours disponible », se remémore Adeline, assistante sociale. Un jour, Marie, sa femme, gérante d’une brasserie, a même dû fermer boutique plus tôt pour partir précipitamment, après un appel de la clinique.
Des médecins border line quand à la légalité
Deux ans plus tard, Adeline revient sur ces péripéties avec le sourire. Elle le concède, il y a eu des moments difficiles, des obstacles à contourner, des solutions à trouver, mais elle refuse de parler de « parcours du combattant » : « J’ai eu de la chance. Franchement, nous nous attendions à pire. » Elle a été bien entourée, notamment par sa gynécologue.
Celle-ci a décidé d’accompagner le couple dans son projet, tout en sachant qu’elle était « borderline quant à la légalité », confie-t-elle. Un euphémisme : l’article 511-9 du code pénal prévoit 75 000 euros d’amende et cinq ans de prison à toute aide apportée à une personne souhaitant pratiquer une PMA à l’étranger. Trouver un gynécologue qui accepte d’effectuer les examens nécessite donc souvent de la motivation et une dizaine de coups de fil.

Pour Adeline et Marie, le plus difficile a été de concilier les rendez-vous médicaux avec leur vie professionnelle. Photo : Célia Mascré/EPJT
Chez les hommes aussi, trouver la bonne personne constitue l’une des priorités. Contraints de se tourner vers une GPA, ils doivent affronter d’autres problèmes. Emmanuel et Sylvain ont vécu aux Etats-Unis quelques années. Une fois rentrés en France, ils ont décidé de fonder une famille. Ils ont dû alors retraverser l’Atlantique pour faire appel à une agence dans l’Oregon : « Nous avons rencontré les responsables et avons passé un test psychologique. C’était exactement ce que l’on voulait : une petite agence familiale. »
L’établissement leur a transmis les photographies de plusieurs donneuses d’ovocytes afin qu’ils puissent choisir. Ils ont ensuite rencontré différentes mères porteuses, dont Samantha : « À la base, elle voulait aider un couple hétéro », précise Emmanuel. Pour confier la grossesse de son enfant à quelqu’un, il faut une alchimie. La jeune femme, 22 ans à l’époque, est très croyante : « Son intérêt n’était pas financier, mais religieux : son but c’était d’aider son prochain », raconte Emmanuel. A la naissance des jumeaux, Samantha s’est même fait tatouer : « J’ai ma place au paradis. »
Les deux hommes estiment à 120 000 euros la somme engagée pour que Rose et Côme, 4 ans, viennent au monde. Une somme que tout le monde ne peut pas débourser pour avoir un enfant. Ce montant comprend : le règlement de l’agence, le don d’ovocytes, la FIV et tous les examens médicaux nécessaires. Il a aussi fallu dédommager la mère porteuse pendant toute la durée de son arrêt de travail et payer les allers-retours aux Etats-Unis. Samantha ne touche, elle, que 5 à 10 % du prix total.

Illustration : Tot’
Léa et Claire n’ont pas eu à dépenser autant d’argent. Mais elles ont aussi connu leur part de soucis. Léa a connu une grossesse compliquée. Dès le troisième mois, elle a dû cesser de travailler. Claire l’a soutenue et accompagnée au mieux, conjuguant sa nouvelle vie professionnelle et la grossesse de sa femme, puisqu’elles se sont mariées peu de temps avant d’apprendre la grossesse de Léa.
Bébé est là
Illustration Tot’
Huit mois et demi de grossesse, les premières contractions. Léa appelle Claire au bureau : « Reviens, il faut qu’on y aille ! » Quelques heures plus tard, le petit Nathan pointe le bout de son nez. Ce moment bouleverse leur vie. Elles ne sont plus seulement un couple, elles ont fondé une famille.
« Pendant l’accouchement j’avais l’impression de l’aider à naître. C’était magnifique. J’ai coupé le cordon », s’émeut Marie. Lorsqu’elle raconte la naissance de Maël, les larmes lui montent aux yeux. Elle a eu un fils de son premier mariage avec un homme. Elle a vécu la maternité des deux côtés, celui de la femme qui accouche et de celle qui soutient. « Les histoires de parents sociaux sont encore plus belles. Un truc magique se produit », constate Rosine en pensant à la relation de sa fille Julia avec sa femme Nathalie.
En couple depuis une quinzaine d’années, Emmanuel et Sylvain ont tous les deux donné leurs gamètes pour réaliser une fécondation in vitro avec les ovocytes d’une donneuse. Résultat : Samantha, la mère porteuse, a accouché de faux jumeaux dont les deux pères peuvent chacun revendiquer la paternité.
Emmanuel est le père biologique de Rose et Sylvain celui de Côme. Pendant que Sylvain réveille ses enfants de la sieste, Emmanuel évoque sa relation avec eux : « Rose je la connais par cœur, elle est comme moi. Avec Côme, j’ai une relation plus fusionnelle. Il est comme Sylvain. » La petite famille vit en région parisienne. Les jumeaux ont aujourd’hui 4 ans, et sont entrés à l’école cette année. Seul petit problème : ils n’ont pour l’instant, aux yeux de la loi, qu’un père. Tant qu’Emmanuel et Sylvain ne sont pas mariés, ils ne pourront pas adopter l’enfant biologique de leur compagnon.

Côme et Rose, nés d’une GPA aux Etats-Unis, ont désormais 4 ans. Ils sont citoyens américains. Photos : Célia Mascré/EPJT
« Si le parent biologique est hospitalisé, par exemple, et qu’il ne peut pas prendre les décisions qui ont un impact sur l’avenir de l’enfant, son compagnon n’a aucun droit. Il ne peut pas donner son autorisation pour que l’enfant subisse une opération chirurgicale, l’inscrire dans un établissement scolaire, accepter qu’il pratique un sport dangereux… », précise Virgine Truffley, juge des affaires familiales dans le Nord. En bref, toute chose qui relève des attributs de l’autorité parentale.
Dans le sud de la France, Charlotte et Hélène peuvent regarder avec fierté Irène, leur fille de 3 ans. Elles ont mis quatre ans avant que l’une d’elles ne réussisse à être enceinte. Charlotte a reçu neuf inséminations, Hélène six. Au total, dix-huit allers-retours aux Pays-Bas, beaucoup d’argent dépensé et de déceptions. Finalement, elles ont accepté l’aide d’un ami pour procéder à des inséminations artisanales et Hélène est devenue la mère d’Irène.
« Le fait que les adoptants soient homosexuels ne peut être un élément en soi pour refuser l’adoption »
Virginie Truffley
Dernière étape de ce long parcours semé d’embûches : il y a un an, la loi a reconnu la parenté de Charlotte. L’illustratrice de 39 ans a été surprise de l’effet de l’adoption : « Nous pensions que ce n’était que des papiers, mais cela nous a vraiment sécurisées. Je ne me suis pas sentie plus mère qu’avant, mais cela a assis notre famille. »
Depuis quelques années les tribunaux rendent des décisions favorables aux couples de même sexe. Ils ne peuvent plus les discriminer. « Le fait que les adoptants soient homosexuels ne peut être un élément en soi pour refuser l’adoption », affirme Virginie Truffley. Le tribunal prononce l’adoption si les conditions de la loi sont remplies (parents mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans, etc.) et si « l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Si la situation des homosexuels s’est globalement améliorée, cela n’empêche pas les connaissances du couple de tenir des propos homophobes. Les dissensions peuvent survenir au sein des familles, parfois jusqu’à la rupture. Adeline a dû faire face à de violentes critiques de la part de ses proches.
Mariée à un homme, elle a tout quitté après avoir rencontré Marie. Au départ, même sa mère a eu du mal à l’accepter. Au fil du temps, cette dernière a constaté la solidité du couple. Rassurée, lors de la grossesse d’Adeline, elle lui a même avoué : « Je ne suis pas inquiète pour l’enfant qui arrive chez vous. »

Comme tous les enfants de son âge, Maël, 1 an et demi, trouve les bras de sa mère, Adeline, à son réveil. Photo : Célia Mascré/EPJT
Catholique, Adeline ne sait plus, aujourd’hui, où elle en est, vis-à-vis de sa foi. Elle qui allait à la messe tous les dimanches a eu « l’impression d’être schizophrène » au moment du débat sur le mariage pour tous : « Comment pouvais-je aller m’asseoir à l’église à côté de gens qui manifestaient contre ce que j’étais ? » se souvient-elle. Face aux insultes sur Facebook, elle a décidé de fermer son compte et a rompu avec la majeure partie de ses connaissances.
Si 39 % des Français estiment encore qu’une famille homoparentale n’est pas une famille « à part entière » (sondage Ifop, 2014), Marie reste optimiste : « Je pense que les futures générations seront moins obtuses. Il y a vingt ans, élever son enfant seul était honteux. Maintenant, c’est une réalité qui ne choque plus personne », analyse-t-elle.
Pour les jumeaux, Côme et Rose, avoir des parents homosexuels est « leur normalité », estime Sylvain. La clé pour que l’enfant comprenne et accepte son histoire : la transparence. « Expliquer son origine à l’enfant est fondamental », affirme le pédiatre Marc Pilliot, auteur d’une lettre ouverte aux politiques en 2013 pour défendre les droits à l’adoption des homosexuels. Il poursuit : « Le fait de dire les choses avec des mots simples dès le départ, très tôt, clarifie la situation et l’enfant grandit sur des bases tout à fait saines. »
Adeline et Marie ont écrit un livre pour expliquer sa naissance à Maël. Emmanuel et Sylvain aussi tiennent à ce que leurs enfants connaissent leur origine.
Nathan a bien grandi. Il va maintenant à l’école. Du haut de ses 4 ans, il dessine sa maison et deux femmes à côté dans le jardin. « Maîtresse, pourquoi Nathan il fait deux dessins ? », demande un camarade de classe. La maîtresse lui répond : « Parce que Nathan a deux mamans. » La discussion commence. Nathan sait raconter son histoire : « Un gentil monsieur qui habite en Belgique a donné sa petite graine à maman Léa. Et après je suis né. »
Quand la sonnerie retentit, il court dans les bras de Claire et donne son dessin à Léa : « Bonne fête mes mamans chériiies ! » Les parents d’élèves regardent la scène avec tendresse. Ils ne voient plus la particularité de cette famille et aucun d’entre eux n’oserait dire que Nathan n’est pas équilibré. Comme tous les enfants désirés.
« Les couples homosexuels font une sacrée réflexion sur eux-mêmes, ce que peu d’hétérosexuels font, note le Dr Marc Pillot. Ce sont des enfants bien soutenus, bien sécurisés par un entourage très aimant et responsable. » C’est pourquoi ces enfants sont aussi épanouis que les autres comme le prouvent de nombreuses études. En 2013, Olivier Vecho, maître de conférences en psychologie à Nanterre, dénombrait 800 publications sur l’homoparentalité depuis les années soixante-dix, sans qu’aucune ne permette « de dire qu’il y a plus de problèmes chez les enfants élevés dans un contexte homoparental ».
L’histoire de Nathan, c’est celle de tous ces enfants nés de parents de mêmes sexes. Claire et Léa n’existent pas, elles sont le fruit de ces histoires de couples qui s’aiment et s’engagent sur ce chemin, aussi sinueux et éprouvant qu’excitant. Tous s’accordent à dire que leur parcours vers la parentalité est une aventure magique.

Claire, Nathan et Léa. Illustration Tot’
