Les aventures d’Arthur, le silure de la Loire
Voyage en eaux troublesPhoto Laure Colmant
La Loire, sa nature sauvage, ses poissons, ses plantes… Et ses polluants. Tous les organismes présents dans le fleuve sont contaminés par des pesticides. Les centrales nucléaires utilisent l’eau pour fonctionner, sans conséquence grave. Sauf en cas d’accident. Face à ces menaces multiples aux effets mal connus, la vigilance s’organise. Jusqu’ici, tout va bien.
Par Camille Charpentier, Noémie Lair, Jeanne Laudren et Guillaume Soudat
Le parcours d’Arthur permet de comprendre ce que l’on peut trouver dans l’eau et connaître les organismes présents dans la Loire, d’Orléans jusqu’à la région tourangelle. Eau fluorescente, pesticides, passage dans de l’eau rejetée par des centrales nucléaires : pour lui et ses congénères, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Parcourez le fleuve en compagnie d’Arthur le silure
Les gardiens de la Loire
Au cœur de la Beauce, des colorants sont versés dans l’eau pour comprendre la propagation des pollutions. Photo : Jeanne Laudren/EPJT
Objet de toutes les surveillances, l’eau de la Loire est régulièrement prélevée par l’Agence de l’eau. Chacun peut se donner une idée de l’état des cours d’eau de la région en se rendant sur l’application Qualité Rivières, grâce à une carte interactive. Les informations sont issues des analyses effectuées par les Agences de l’eau partout en France. Chaque année, elles collectent plus de 10 millions de données sur l’état des cours d’eau sur plus de 500 points. En un coup d’œil, ceux en bon état ou pollués apparaissent. Un bon outil qui permettrait à Arthur de choisir son lieu de vie.
Que se passerait-il si un camion citerne transportant des polluants déversait son contenu dans la Loire après un accident ? Partout en France, le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de diffuser les informations en matière d’accidents technologiques et de les regrouper dans la base ARIA (Analyse, recherche et information sur les accidents). En Indre-et-Loire, la dernière pollution aquatique recensée est survenue sur une exploitation agricole, en novembre 2015. La Petite Choisille, un affluent de la Loire, a été contaminée par « 100 mètres cubes de lisier rejetés pendant la nuit ». Une chance qu’Arthur le silure ne soit pas trouvé là. Cela aurait pu lui être fatal.
Il aurait en revanche pu traverser la nappe d’hydrocarbures répandues sur 10 kilomètres sur la Loire en novembre 2011, suite à un accident survenu sur la structure d’un barrage. Ou dans une nappe d’eau fluorescente, en décembre dernier. Rien d’inquiétant dans ce dernier cas : il ne s’agissait que d’un colorant totalement inoffensif aussi bien pour l’homme que pour les animaux.
Et la Loire devint fluo
À une dizaine de kilomètres d’Orléans, les étudiants de l’école polytechnique d’Orléans (Loiret) enfilent casques et gilets fluorescents. Bidons de fluorescéine sur l’épaule, ils se dirigent vers un point forage situé en plein champ, au cœur des calcaires de Beauce. Leur mission du jour : injecter 3 litres de ce colorant à 26 mètres sous terre. « C’est un produit marqueur qui permet de suivre la propagation de l’eau dans le système souterrain, explique Nevila Jozja, ingénieure de recherche et directrice adjointe de la Cellule d’expertise et de transfert en traçages appliqués à l’hydrogéologie et à l’environnement. Une fois le produit injecté, on le prélève à un point de suivi. Cela permet de vérifier la liaison hydraulique et de déterminer la vitesse de propagation dans les milieux souterrains. Et donc de détecter le trajet d’une éventuelle pollution. » Durée de l’expérience : deux jours, le temps que le produit arrive au point de suivi.
L’histoire ne dit pas si notre Arthur s’est étonné en traversant cette eau d’un beau vert fluo.
Cette fois, le test n’est qu’une démonstration à destination des étudiants pour comprendre l’organisation des eaux souterraines. Mais la technique est réellement employée pour connaître la composition des sols et prévenir les pollutions. « Si jamais il y a une pollution, le traçage montre comment elle va se propager dans l’eau. Cette méthode aide à protéger les captages en eau potable », précise Nevila Jozja.
Elle permet notamment d’établir les périmètres de protection des bassins d’alimentation, afin de les préserver des pollutions. L’eau prélevée sera ensuite envoyée au laboratoire d’appui de l’Institut des sciences de la terre d’Orléans. Cela permettra aux étudiants et aux chercheurs de mesurer les concentrations de colorants et d’en tirer des conclusions sur son trajet et sa composition.
Si la surveillance est accrue pour prévenir les accidents, une veille d’un genre différent s’organise pour assurer la propreté de la Loire. En 2016, armés de leurs sacs poubelles, près de 2 500 bénévoles parcourent les bords du fleuve pour ramasser les déchets abandonnés. Car les incivilités existent toujours, même si la situation s’améliore. « Il y a trente ans, il n’était pas rare de trouver des objets abandonnés dans le fleuve ou sur ses berges. On pouvait apercevoir des vieux frigos, des pneus et même des scooters, se souvient Jean-Marc Berthon, responsable de Fleuves et rivières propres, une association qui organise des collectes de déchets. Il y a eu une prise de conscience depuis la fin des années quatre-vingt. »

Les berges de la Loire sont loin d’être impeccables pour autant. Des objets non biodégradables, bouteilles en plastique en tête, font désormais partie des déchets les plus ramassés près de l’eau. Ils risquent de se retrouver dans l’estomac d’Arthur, les silures étant peu regardants sur ce qu’ils ingèrent.
Mais les déchets abandonnés et les accidents signalés ne sont que la partie visible des pollutions. La principale source de contamination de la Loire reste les pesticides car le fleuve traverse des régions agricoles.
Les pesticides font de la résistance
La France est le premier consommateur de pesticides en Europe. Photo : Noémie Lair/EPJT
Quatre-vingt-dix pour cent des Français ont accès à une eau du robinet de qualité, affirme l’UFC-Que choisir. Un chiffre encourageant, mais qui questionne notre silure : 4 % des Français, ça fait combien de personnes qui consomment une eau polluée ? Environ 2,8 millions, précise l’association. Tout de suite, l’eau française paraît moins limpide.
Tout le long dans la Loire – Arthur ne le remarque sans doute pas –, des résidus de pesticides polluent l’eau. Chlortoluron, bentazone, atrazine, fénuron, lénacile, etc., sont les principaux poisons présents dans les cours d’eau de la région. Des noms savants, peu connus, sauf peut-être l’atrazine. Même Arthur a dû en entendre parler. Les médias ont rapporté plus d’une fois de ce produit, interdit de distribution depuis 2002 et d’utilisation depuis 2003.
Cet herbicide était facile à utiliser et efficace. Il a été couramment employé pendant quarante ans. Alors pourquoi l’avoir interdit ? Parce qu’il a une forte propension à contaminer les eaux par ruissellement et par infiltration.
Le Code de santé publique impose un taux de pesticides inférieur à 0,1 microgramme par litre d’eau pour que cette dernière soit potable. Sans quoi, elle est déclarée non conforme. Dans les zones où l’atrazine était utilisée, ce seuil était largement dépassé. Jusqu’à 290 fois dans les dernières années de son utilisation dans les rivières de la Flume en Ille-et-Vilaine. « Sur les dix départements du Grand-Ouest, les départements des régions Bretagne, Pays-de-Loire et le département des Deux-Sèvres, 2,7 millions de personnes ont été alimentées en 1997 par une eau non conforme », souligne un rapport parlementaire.
L’atrazine est un produit éminemment toxique pour la flore, mais aussi pour la faune. Il est même nocif pour les êtres humains s’ils l’inhalent ou en cas de contact avec la peau. Cela va de l’irritation cutanée aux atteintes neurologiques. L’atrazine aurait également des conséquences sur la reproduction et provoquerait des retards de croissance pour le foetus. En revanche, elle ne ferait pas partie des produits cancérigènes d’après le Centre international sur le cancer.
En 2015, des traces d’atrazine ont été retrouvées dans les eaux distribuées au sud de l’Eure-et-Loir et au nord du Loiret. Des zones matérialisées par des points rouges sur la carte de l’ARS. Les points roses eux, représentent l’atrazine déséthyl. Ce nouveau nom désigne une molécule produite par la dégradation, la transformation de l’atrazine dans le sol. Problème, l’atrazine déséthyl est encore plus toxique que l’atrazine d’origine.
Une perte de vigilance chez les animaux
Fait surprenant : les zones polluées à l’atrazine déséthyl ne sont pas les mêmes de 2014 à 2015. En Indre-et-Loire par exemple, la molécule est repérée dans les eaux de Souvigny-de-Touraine en 2014 et l’année suivante, elle est à Beaumont-la-Ronce, situé 50 kilomètres plus au nord. Alors la molécule se déplace-t-elle au fil des années ou est-elle toujours utilisée malgré l’interdiction ? D’après Pascal Grossier, ingénieur du génie sanitaire à l’ARS, ni les agriculteurs ni les particuliers ne sont à l’origine de cette apparition. En fait, « le passage de la molécule dans l’eau se fait avec le lessivage des sols, un lessivage qui se fait avec la pluie. La pénétration de la molécule va donc se faire en fonction de la pluviométrie ».
« Parmi les 54 substances recherchées, les pesticides et les métaux, notamment le mercure, sont les plus fréquents »
L’interdiction d’utiliser certains pesticides donne des résultats encourageants. Entre 2007 et 2015, le nombre de zones non conformes répertoriées par l’Agence de santé en région Centre a été divisé quasiment par deux. Il en reste encore 97. L’Eure-et-Loir est particulièrement touché puisqu’à lui seul, il comptabilise 63 zones non conformes. Autant dire que pour Arthur, il est hors de question d’y mettre une seule nageoire.
Mais ce qu’Arthur ne sait pas, c’est qu’il est déjà contaminé. Lors de leur étude écotoxicologique du bassin de la Loire, René Rosoux, ancien directeur du muséum d’Orléans, Charles Lemarchand, écotoxicologue, et Philippe Berny, vétérinaire-toxicologue, ont répertorié les polluants retrouvés dans les animaux. Et le résultat est sans appel : « Parmi les 54 substances recherchées systématiquement, les pesticides organochlorés, les polychlorobiphényles (PCBs) et les métaux, notamment le mercure, se sont avérés les plus fréquents. »
Aucune espèce n’est menacée par ces contaminants. Mais ces derniers « peuvent provoquer une perte de vigilance de la part des animaux », si on en croit René Rosoux. Le rapport des chercheurs soulignent de plus que ces polluants peuvent constituer un facteur aggravant pour des animaux déjà fragilisés : « L’anguille européenne, menacée par la surpêche, la dégradation des habitats, la perturbation des corridors de migration et les conséquences des changements globaux sur les courants marins est par ailleurs une espèce fortement accumulatrice pouvant être impactée par la contamination par les PCBs ou encore le mercure ».
Des risques mal connus pour l’homme
Les pesticides de dernière génération apparaissent beaucoup moins chez les animaux étudiés que les anciens pesticides, organochlorés, très persistants et qui ont été progressivement interdits. Arthur le silure s’en réjouit… Mais il risque de déchanter rapidement. Les scientifiques, eux, restent très prudents. Si ces nouveaux pesticides sont moins présents dans leurs analyses, ce n’est pas forcément parce qu’ils sont moins toxiques et persistants que leurs prédécesseurs. Leurs molécules n’ont peut-être pas encore atteint les animaux du fait de leur récente utilisation.
Très peu d’informations circulent sur les risques éventuels d’une pollution de l’eau sur la santé humaine. Pour ce qui est des pesticides, les conséquences sur la santé sont surtout connues pour les personnes qui les utilisent régulièrement. Le danger pour les agriculteurs a été démontré de nombreuses fois. En 2013, une expertise pilotée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale indique qu’il semble exister un lien entre une exposition régulière et, entre autres, la maladie de Parkinson ou le cancer de la prostate.
Mais le risque est tout aussi grave pour les femmes enceintes et, surtout, leur futur bébé. D’après cette étude, les pesticides pourraient augmenter le risque de fausses-couches et celui de malformations congénitales (ni héréditaires ni génétiques) pour les bébés. Ils pourraient également avoir un impact sur la stérilité.
Les pesticides seraient également cancérigènes et mutagènes, c’est-à-dire qu’ils pourraient transformer la structure des cellules en altérant les chromosomes, leur forme comme leur nombre. Cela peut aboutir à une importante fabrication de certaines cellules, ce qui peut correspondre au début d’un cancer (le cancer étant une prolifération de cellules étrangères au corps humain).

Pour ce qui est de la présence de résidus de pesticides dans l’eau, leurs conséquences sont plus difficiles à prouver. Cinq molécules sont suspectées d’être cancérigènes d’après l’ARS : « Le glyphosate, le malathion, le diazinon, le tetrachlorvinphos et le parathion ont été classés par le Centre international de recherche contre le cancer en mars 2015. » L’Association santé environnement France l’affirme, la pollution de l’eau peut avoir des conséquences sur la santé humaine. « Les nitrates empoisonneraient le sang chez les nourrissons par blocage de l’hémoglobine interdisant le transport de l’oxygène (maladie bleue) et les nitrites seraient cancérigènes à long terme, même à faible concentration, s’ils sont associés à certains pesticides. Les métaux lourds, quant à eux, provoqueraient des troubles digestifs, respiratoires, nerveux et cutanés. »
Bref, pesticides ou résidus ne sont ni les amis des silures ni ceux des êtres humains.
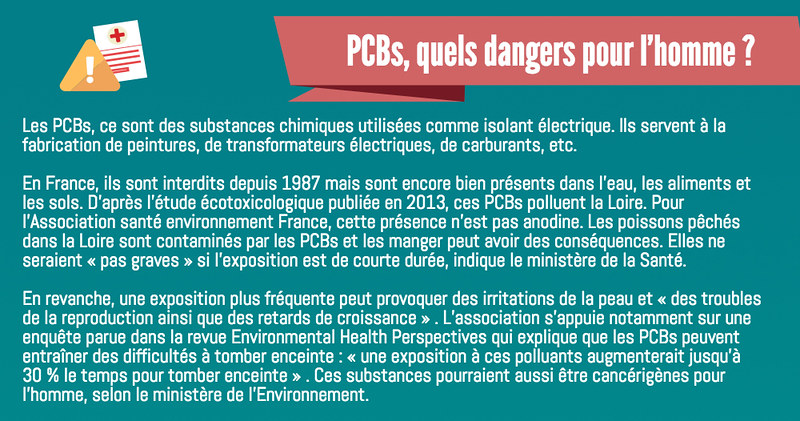
Les agriculteurs sont de plus en plus conscient de ces risques. Encouragés par les pouvoirs publics qui s’engagent à verser des aides à ceux qui convertissent leur production au bio, ils sont nombreux à changer de cap. D’après l’Agence Bio, l’agriculture biologique comptait 31 880 producteurs français en 2016. Soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente.
« Quand j’ai décidé d’arrêter les produits phytosanitaires, je savais que j’aurai obligatoirement des baisses de rendements et donc de revenus »
Dominique Gibon fait partie de ceux qui ont choisi la reconversion. Depuis 2009, ce producteur laitier du Louroux, au sud de Tours, est labellisé bio. Un choix poussé par la curiosité mais aussi par la peur : « Mon père, lui aussi agriculteur, était atteint de Parkinson. La maladie a été reconnue comme maladie professionnelle due aux pesticides. »
Mais le chemin est rude. L’agriculture bio produit moins et coûte plus cher : « Aujourd’hui, utiliser les pesticides est un impératif si on veut rester au même niveau de production. On n’a pas les savoir-faire pour produire au même niveau avec les techniques du bio. Quand j’ai décidé d’arrêter les produits phytosanitaires, je savais que j’aurai obligatoirement des baisses de rendements et donc de revenus. J’y ai consenti. Certains ont peur de se faire bouffer. »
D’autant que durant les trois premières années de leur reconversion, les agriculteurs n’ont pas le label bio et ne peuvent donc vendre leur produits au prix bio. Les aides à la reconversion sont insuffisantes. En 2015, une enveloppe a été attribuée à la région Centre pour les cinq années à venir. Mais l’intégralité de cette aide a été utilisée en une seule année. Depuis, il n’y a donc plus d’aide possible. Pourtant, les agriculteurs sont toujours nombreux à en faire la demande.
Centrales nucléaires, jusqu'ici, tout va bien…
Le site de Chinon est l’une des dix-neuf centrales nucléaires de France. Photo : Jeanne Laudren/EPJT
Toute sa vie, Arthur a évité de nager près des centrales nucléaires. Sa grand-mère lui répétait toujours : « Ne t’approche pas, c’est dangereux. » Son père, lui, racontait l’histoire d’un accident survenue en Ukraine et qui avait fait de gros dégâts. Notre silure ne sait pas trop quoi penser de tout ça…
Il n’est pas le seul à s’interroger. Le 28 janvier 2017, on peut lire dans La Nouvelle République que « le public est toujours avide d’informations concernant le nucléaire ». Ce jour-là, deux cents personnes se sont rassemblées pour une réunion publique sur les nouvelles mesures de sécurité qui seront mises en place à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux.
Après la catastrophe de Fukushima en mars 2011, Henri Proglio, alors patron d’EDF, a envoyé une lettre à ses employés dans laquelle il évoque une « période délicate pour l’industrie du nucléaire ». Il y explique les consignes de communication à appliquer : « Salarié(e) d’un groupe dont l’activité nucléaire est connue et reconnue, (…) il importe que vous soyez en mesure de rassurer sur les moyens qu’EDF, en tant qu’industriel responsable, met en œuvre en permanence pour assurer la prévention des risques de ses centrales. »
En France, uniquement des incidents
Rassurer des Français méfiants est alors une nécessité pour EDF. Tchernobyl, en 1984, a révélé au monde entier que les centrales nucléaires pouvaient avoir des effets dévastateurs sur l’environnement. Fukushima est une confirmation. Tous deux sont classés comme « accidents majeurs » sur l’échelle Ines, ce sont les plus gros jamais recensés dans le monde. En France, très peu d’accidents ont eu lieu, uniquement des incidents. Arthur, lui, n’a pas été en contact avec de fortes doses de radionucléides (atomes radioactifs capables de se transformer en d’autres).
Pourtant, en novembre 2016, Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n’hésite pas à asséner que « la situation du nucléaire en France est très inquiétante ». Une anomalie générique vient d’être identifiée sur les générateurs de vapeur. Après une procédure de grande ampleur menée fin 2016, l’ASN met à l’arrêt douze des cinquante-huit réacteurs français. Mi-janvier 2017, neuf d’entre eux sont remis en service.
Le parc nucléaire vieillit
Cela ne rassure pas vraiment Arthur le silure. Le parc nucléaire français, composé de 19 centrales, vieillit. Leurs réacteurs avaient initialement une durée d’exploitation fixée à vingt-cinq ans. Aujourd’hui, 52 des 58 réacteurs sont âgés de plus d’un quart de siècle. La fumée qui se dégage de ces tours, visible de loin, inquiète, même si ce n’est que de la vapeur d’eau.
Des groupes antinucléaires alimentent cette peur en expliquant, par exemple, que les centrales « rejettent dans les fleuves des substances chimiques (…) qui vont migrer et se retrouver dans les organismes des êtres vivants et dans les sédiments ». Des substances chimiques et radioactives seraient déversées dans les milieux aquatiques et auraient donc un impact sur les êtres vivants qui les composent. En réalité, c’est faux.
« Dans les années quatre-vingt, la centrale de Chinon rejetait une eau plus chaude de 10 °C. Cela avait un impact inacceptable sur la faune et la flore »
En France, deux instituts encadrent le fonctionnement des centrales : l’IRSN (Institut de radioprotection de sûreté nucléaire) et l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire). Ils effectuent des opérations de maintenance des réacteurs les uns après les autres. Les exploitants d’installations nucléaires comme EDF ont pour obligation de déclarer les événements extraordinaires qui ont lieu dans les centrales. Ces éléments significatifs pour la sûreté et pour la radioprotection sont classés par l’ASN sur l’échelle internationale Ines en fonction de leur gravité.
Ces deux « gendarmes du nucléaire » vérifient que les centrales répondent aux exigences qu’ils imposent. Elles évoluent avec le temps et deviennent de plus en plus strictes. L’objectif est de préserver au mieux la faune et la flore présentes à proximité des centrales nucléaires. Ces dernières ont besoin d’eau pour fonctionner et sont donc situées près de fleuves et rivières. Une partie de cette eau prélevée est ensuite rejetée dans sa source.
Dans les années quatre-vingt, l’eau qui servait au fonctionnement de la centrale de Chinon était pompée dans la Loire et rejetée à une température de 10 °C plus élevée. Arthur le silure évitait alors de s’en approcher. « Un impact inacceptable sur la faune et la flore », selon José Roda, ingénieur de l’environnement à la centrale de Chinon.
Cette question de la température de l’eau est « l’une des préoccupations majeures du réseau Sortir du nucléaire, explique Charlotte Mijeon, chargée de communication pour le réseau. Les deux autres sont les apports en eau et les rejets chimiques et radioactifs ».
Depuis 1982 et la construction de nouveaux réacteurs à la centrale de Chinon, la réglementation ne tolère plus que 1 °C de différence entre l’eau pompée et celle rejetée. Une réglementation que le réseau Sortir du nucléaire juge peu efficace. En janvier 2008, dans un article intitulé « Le Nucléaire et l’eau », il affirme ainsi que « l’eau chaude émise par la centrale et provenant du circuit de refroidissement va provoquer une mortalité ou des troubles chez la faune aquatique ».
« Les centrales enrichissent en éléments radioactifs les sédiments de la Loire »
Catherine Boisneau, enseignante-chercheuse dans le département environnement de l’université François-Rabelais, a participé pendant une quinzaine d’années au suivi de la qualité de l’eau à la centrale de Chinon. « Cette centrale n’a pas eu d’impact particulier sur la qualité de l’eau », affirme-t-elle.
Des éléments radioactifs ont cependant été découverts dans les sédiments de la Loire après un accident de type 4 à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux le 13 mars 1980. Sur l’échelle Ines, il s’agit d’un « accident aux conséquences locales », le plus grave actuellement recensé en France.
Ce jour-là, une partie du circuit de refroidissement du réacteur n° 2 est obstrué par un morceau de tôle. Le réacteur est arrêté en urgence après que plus de 20 kilos d’uranium sont entrés en fusion, ce qui a entraîné une augmentation soudaine de la température. Les conséquences environnementales sont restées cachées au grand public pendant des années.

Jusqu’à ce que Canal+ diffuse, dans son émission « Spécial Investigation », le documentaire Nucléaire, la politique du mensonge ? le 4 mai 2015 soit trente-cinq ans plus tard. Le documentaire débute ainsi : « Nous allons vous révéler que du plutonium, substance hautement radioactive, a été déversé dans la Loire en toute illégalité. » Ancien dirigeant d’EDF, de 1967 à 1987, Marcel Boiteux reconnait que des déversements de plutonium ont été pratiqués pendant cinq ans. « Oui, bien sûr, ce n’est pas bien, mais ce n’est pas grave », insiste-t-il.
Après la diffusion de ce documentaire, l’IRSN mène sa propre enquête et, le 17 mars 2016, elle publie une note intitulée « Rejets de plutonium dans la Loire ». Les éléments collectés « attestent de rejets d’origine industrielle dans la Loire qui pourraient avoir pour origine les accidents survenus en 1969 et en 1980 sur les unités SLA1 et SLA2 du CNPE [Centre nucléaire de production d’électricité, NDLR] de Saint-Laurent-des-Eaux ». Mais, comme le souligne l’IRSN, « les traces des rejets de 1980 ne sont plus perceptibles dans la Loire dès 1994 ».
Comparées à la radioactivité naturelle, les traces de plutonium présentes dans les sédiments de la Loire sont dérisoires
Des traces de plutonium sont néanmoins toujours présentes dans les sédiments du fleuve. Frédérique Eyrolle, chercheuse en géochimie à l’IRSN, a participé à cette collecte sédimentaire et à son analyse. Si des traces de plutonium sont bien présentes dans la Loire, elles sont « presque dérisoires ». Le plutonium possède un rayonnement de type Alpha, c’est-à-dire qu’il a une faible portée, de quelques centimètres seulement. Il n’y a donc aucun risque à toucher ces traces de plutonium.
Par contre, comme l’explique Christelle Adam, cheffe du laboratoire d’écotoxicologie des radionucléides, « si on ingère ce plutonium, il peut y avoir des effets nocifs. Tout dépend de la quantité ingérée. » Si Arthur le silure ingurgite du plutonium, il risque une cassure et une mutation de son ADN.
En temps normal, les êtres vivants sont capables de réparer ces cassures. Mais s’il y en a trop, à cause de l’ingestion d’une dose trop élevée de plutonium, l’être vivant peut procéder à un « suicide cellulaire ». Il choisit donc de se séparer d’une cellule pour préserver les autres, ce qui n’a aucun impact sur lui. S’il échoue, alors il risque de développer un cancer.
Pour rappel, tout élément présent autour d’Arthur le silure est radioactif : l’eau, l’air, les êtres vivants. Comparées à cette radioactivité naturelle, les traces de plutonium présentes dans les sédiments de la Loire sont dérisoires. Il faudra malgré tout attendre au moins 120 000 ans pour que le plutonium disparaisse totalement.
Et maintenant ?
Le silure représente jusqu’à 40 % du volume de poissons pêchés par les professionnels. Photo : Guillaume Soudat/EPJT
Pendant trente ans, Arthur le silure navigue dans les eaux troubles de la Loire. Mais la vieillesse et les composants chimiques ont finalement raison de sa vigilance. Sa gourmandise le trahit : le hareng dont il a voulu faire son casse-croûte est en fait un appât. Comme de nombreux silures, Arthur rend son dernier soupir au bout d’une canne à pêche. Son aventure se termine au rayon conserves, dans des bocaux de rillettes de silure aux tomates séchées. Lui qui pensait que les hommes se méfiaient de sa chair de « poubelle de la Loire »… Après s’être délecté de tant de poissons, vers de terre, invertébrés et autres sacs plastiques, il cède sa place en haut de la chaîne alimentaire. Pour le plaisir des plus fins gourmets.

