
« Le fait divers, c’est comme le porno, tout le monde en lit mais personne ne le dit », parole de journaliste. En podcast, polar, série télé, flash info, ce genre journalistique ne s’est jamais aussi bien porté malgré sa mauvaise réputation. Reflet d’une société en mouvement, il évolue constamment, comme en presse écrite où il tente de se renouveler dans une logique à deux vitesses.
Par Clotilde COSTIL


Police-Justice : face à la concurrence, la presse écrite tente de faire diversion
Dans son livre, Un temps de chien, Edwy Plenel disait plaider pour « la noblesse du fait divers », « qui a mauvaise presse tout en l’ayant abondante ». Aujourd’hui le fait divers est partout, tout le temps, accessible à tous. Télévision, réseaux sociaux ; face à cette nouvelle concurrence du tout direct, la presse écrite, pionnière en matière de fait divers, doit trouver sa place, entre adhésion au modèle de l’information en continu ou récit littéraire.
 ardi 31 janvier 2017. Il est 18 heures passées quand les avocats de Jonathann Daval, meurtrier présumé de son épouse Alexia, prennent la parole devant plusieurs dizaines de micros tendus. Leur client vient de passer aux aveux. Toute la presse française est réunie devant les grilles de la gendarmerie de Besançon.
ardi 31 janvier 2017. Il est 18 heures passées quand les avocats de Jonathann Daval, meurtrier présumé de son épouse Alexia, prennent la parole devant plusieurs dizaines de micros tendus. Leur client vient de passer aux aveux. Toute la presse française est réunie devant les grilles de la gendarmerie de Besançon.
Dans l’obscurité de cette froide soirée de janvier, les visages blêmes des avocats forment un halo de lumière nourri par les flashs des caméras. « Nous défendrons un jeune garçon, qui dans une crise de couple, a, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse », déclare Randall Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval.
A peine prononcée, cette phrase est relayée instantanément sur le Net et alimente les « alertes info » du Monde, du Parisien, de France Info et d’autres médias nationaux. « Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante », poursuit-il. Cette seconde déclaration fait l’effet d’une bombe.
En l’espace de vingt-quatre heures, l’affaire Daval a fait l’objet d’une série de rebondissements qui a mis en lumière un nouvel aspect important : l’accélération du temps judiciaire et médiatique.

Dans la presse, les questions affluent . Elles font les titres de nombreux articles qui creusent la vie privée des Daval pour obtenir des réponses : « Qui est Jonathann Daval, passé de gendre idéal à meurtrier présumé ? » (20 Minutes, 30 janvier 2018), « Quel couple formaient Jonathann et Alexia Daval ? » (BFM-TV, 31 janvier 2018), « Jonathann Daval, la nouvelle Jacqueline Sauvage ? » (Causeur, 2 février 2018).
« Il est évident que l’apparition des chaînes d’information en continu a changé notre manière de travailler, que nous soyons magistrats ou journalistes, souligne aujourd’hui Edwige Roux-Morizot. Au cours de ma carrière j’ai donc été amenée à adapter ma communication, à parler lorsque le moment était approprié et à ne pas en dire trop. » Un de ses confrères, Etienne Manteaux, procureur de la République d’Epinal, confirme : « Ces nouvelles offres ont amené les législateurs à faire évoluer les textes. »
Une accélération du temps médiatique et judiciaire
La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence donne désormais au procureur un pouvoir élargi de communication afin, notamment, d’instaurer un cadre particulier et d’éviter la diffusion d’informations parcellaires, erronées, sans que cette communication conduise à un pré-procès. Affaire Grégory, affaire Maëlys, affaire Daval, c’est devenu un rituel ; à chaque fois, le procureur de la République s’exprime, face caméra lors d’une conférence de presse.
La nouveauté c’est d’abord les chaînes d’info en continu qui donnent l’impression que ces sujets sont partout et tout le temps, comme l’explique au Monde (02/02/2018), Dominique Rizet, consultant police-justice pour BFM-TV : « Elles ont tout balayé, piqué le scoop aux journaux, car elles vont plus vite. » Le « direct-live », le « premier sur l’info » sont des codes qui ont gagné leur place aussi dans les médias traditionnels.
Les réseaux sociaux aussi ajoutent à la forte pression que subissent les journalistes sommés d’être polyvalents. Il y circule des images non-journalistiques qui font le buzz et, parfois, les rédactions considèrent que cela mérite d’en faire une information. Isabelle Labarre, fait-diversière à Ouest-France explique : « Les réseaux sociaux font partie de nos sources, pour le meilleur comme pour le pire. Il nous est arrivé d’être interpellés par une information tombée sur Facebook concernant des tirs à l’arme à feu dans un bus. Après vérification, c’était faux, une fake news. »
Ainsi, pour faire face à la concurrence, le Web oblige la presse écrite à suivre un rythme de production soutenu, de type flash info. Via des contenus multimédias constamment renouvelés qui arrivent directement au lecteur par le biais de notifications « push » et par les publications sur les réseaux sociaux qui donnent une meilleure visibilité, les médias traditionnels se renouvellent dans le champ du fait divers.
Partout, de l’information en continu
Comme à Ouest-France, la majorité des journaux est aujourd’hui dotée d’une équipe de personnes formées à la veille numérique et qui peut vite vérifier, publier, répondre aux demandes des internautes. Le site de France Info représente le mieux cette stratégie « transmédiatique » combinant à la fois articles rédigés et formules multimédias. Cette plus-value de l’information est visible dans le traitement de l’affaire Daval. Des vidéos produites par le média en ligne, Brut, sont reprises par France Info et proposent un décryptage particulier de l’actualité avec des codes narratifs identifiables par le jeune public. L’une d’entre elles aborde la question du féminicide soulevée lors de cette affaire : « Un compte Tumblr intitulé “Les mots tuent” dénonce les clichés sur les violences faites aux femmes, véhiculées dans la presse », peut-on lire dans cette vidéo sous-titrée partagée une centaine de fois sur les réseaux.
Qu’est-ce qu’un fait divers au fond ? « C’est une mise en scène de l’extraordinaire et du surprenant », disait le philosophe et sémiologue Roland Barthes. Une rupture dans le déroulement du quotidien, une information de proximité, qui s’attache aux petites choses et aux tribulations de gens ordinaires. Un fait divers s’inscrit dans une géographie particulière qu’on ne voit pas dans les films ni à la télévision, qui échappe aux yeux des hommes politiques, des écrivains.
Prenons l’affaire Laetitia Perrais, cette jeune femme enlevée, agressée sexuellement puis tuée par Tony Meillon en 2011. Ce drame, qui se déroule dans la campagne nantaise, expose un tableau, celui d’une France périphérique, à la sortie des villes. Un environnement habité par des citoyens dont on parle peu alors qu’il y existe, comme partout, une grande intensité de vie. Ces territoires de province qui ne semblent a priori passionner personne, les médias locaux s’en font les premiers échos.
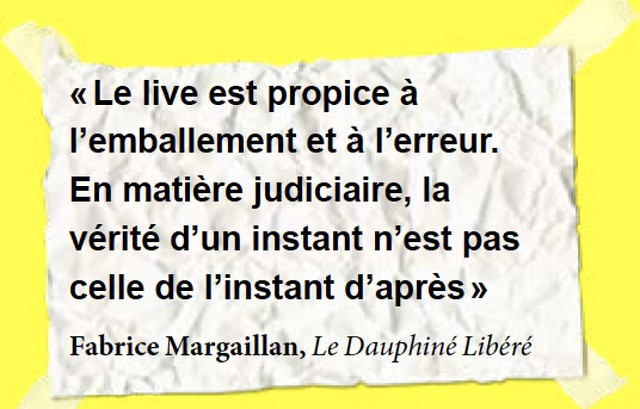
Bien souvent, la presse régionale va jouer un rôle d’agence de presse au niveau local. Durant l’affaire Troadec, en 2017, le journal Ouest-France était souvent premier sur l’info et cité par des médias nationaux dont l’AFP. « Pour nous, c’était clairement une forme de reconnaissance parce que nous avions sorti l’info au bon moment mais en plus, ça signifiait un gage de fiabilité », précise Isabelle Labarre.
Et cette crédibilité est garantie par la « charte du fait divers », souvent réactualisée, et à laquelle les journalistes du quotidien régional se rapportent régulièrement. Elle impose une ligne de conduite très stricte sur ces sujets, notamment en matière d’identité des personnes, de respect du droit à l’image et à la vie privée.
Pourtant, malgré cette proximité avec les faits, il est bien souvent arrivé que la presse locale soit devancée par les médias nationaux qui, basés à Paris, bénéficient de renseignements issus des directions centrales. « En janvier 2014, nous étions les premiers sur une histoire de meurtre à Grenoble. Dès que le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a repris la communication en interdisant localement aux policiers de communiquer, ça a été compliqué, tout ce qui sortait venait du cabinet du ministre », se désole Fabrice Margaillan. Dans ces rédactions aux quatre coins de la France, beaucoup déclarent être victimes d’une forme de parisianisme dans les moyens alloués pour accéder à l’information.

Nicolas Jacquard, journaliste au Parisien, a vite appris à jouer des coudes face aux journalistes de télévision. La publication du quotidien est en « J+1 ». « S’il y a une perquisition à 14 heures chez Nordhal Lelandais, [meurtrier présumé de la petite Maëlys, NDLR], il est inutile de rester devant la maison pour incarner les choses et pour faire des images. » Elles auront évidemment été toutes diffusées à la télé. Du coup, l’objectif est de se poser d’autres questions : « Qu’est-ce que les enquêteurs sont venus chercher et qu’est-ce qu’on va pouvoir révéler demain pour que les gens aient envie d’acheter le journal ? »
Du fait divers à la frontière littéraire
Assise à son bureau noyé dans l’openspace du journal Libération, Patricia Tourancheau a mis son casque antibruit sur les oreilles. Devant elle, un écran projette les dernières images de la prise d’otage de Dammartin-en-Goële. Nous sommes le 9 janvier 2015, les frères Kouachi ont tué deux jours auparavant huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo un garde du corps et un policier. Et sur toutes les chaînes d’information, les mêmes images, les mêmes tons appropriés aux éditions spéciales. Patricia Tourancheau ne se revendique pas spécialement de la « vieille école » mais dit « préférer aborder le fait divers de manière plus narrative, fabriquer des portraits, trouver des angles différents à chaque article ».
« Il nous paraissait pertinent de fouiller le passé en passant par des personnages. C’était une manière pour nous d’apporter plus de chair au récit »
Alice Géraud, rédactrice en chef de LesJours

Les Jours n’a rien inventé : ce format ressemble à s’y méprendre aux premiers faits divers publiés dans des romans-feuilletons de la presse du XIXe siècle. Une recette médiatique qui a marché et qui marche encore. Au moment de la réouverture de l’affaire Grégory, en juin 2017, la rédactrice en chef, Alice Géraud, et toute son équipe décident de traiter cette histoire vieille de trente-trois ans. « On cherchait des papiers où nous ne serions pas emprisonnés par les soubresauts de l’enquête. Il nous paraissait pertinent de fouiller le passé en passant par des personnages. C’était une manière pour nous d’apporter plus de chair au récit. » La recette plaît. À tel point que la rédaction envisage de proposer un feuilleton de l’été 2018 sous forme de podcast.
Raconter pour rire, pleurer (ou les deux)
Qui a donc dit que le fait divers était suranné ? La jeune rédaction de Society a, dès ses débuts en 2015, adopté le fait divers comme une de ses marques de fabrique. Son rédacteur en chef, Stéphane Régy, n’a jamais caché son goût pour ce genre : « Journalistiquement c’est très intéressant non pas pour le côté glauque de la chose, mais parce que c’est souvent une bonne porte d’entrée pour raconter un fait ou un monde qu’on ne voit pas trop. » En bon miroir de la société et de ses évolutions, le fait divers « permet de montrer comme dans l’affaire Grégory, un coin de France dont on ne parle jamais, un moment d’histoire qui est l’ouverture à la société de consommation et les jalousies que ça peut entraîner », poursuit-il.
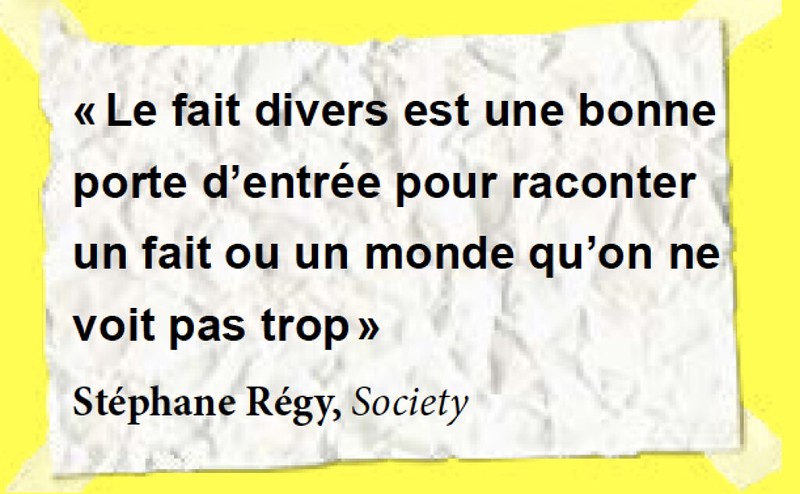

« Dans l’affaire Grégory, les journalistes ont alimenté cette romance jusqu’au pire »
En trois questions, l’ancienne journaliste Laurence Lacour revient sur l’affaire Gregory qu’elle a couvert. Cette histoire marque pour elle un tournant médiatique dans le traitement du fait divers
Comment l’affaire Grégory a-t-elle influencé le changement des pratiques journalistiques ?

Là, ça a été pour moi un éclairage sur la façon dont nous avons été trompés et de la manière dont nous avons trompé notre auditoire. Cela signifiait trois années de fichues à la poubelle. Les dégâts humains, nous les avons touchés du doigt. Peu à peu, les grands principes ont repris un peu leur place. Après l’accusation de la maman de Grégory, il était évident que les journalistes étaient allés trop loin, les juristes ont d’ailleurs rappelé qu’existait la présomption d’innocence. L’écriture de mon livre, Le Bûcher des innocents, m’a aidée à comprendre cet espèce de mouvement dans lequel je me suis trouvée happée et dans lequel, intuitivement, je sentais qu’il y avait dérapages sur dérapages. Aujourd’hui, depuis la loi du 16 juin 2000, la place des victimes et de leurs proches est davantage prise en compte.
Pourquoi cette affaire a tant fasciné les journalistes ?
L. L. Au départ, la fascination tient au caractère romanesque de cette histoire. Ce n’est pas un crime de passage. Même si nous [les journalistes, NDLR] n’avions pas tous les tenants et les aboutissants, nous avons vite compris que ça s’inscrivait dans une narration déjà fournie et donc d’une certaine manière, nous avons voulu prolonger ce récit. Il y a plusieurs éléments qui contribuent à la « recette » narrative de l’histoire : le corbeau et l’importance de l’image notamment. Pour la première fois, dans la presse française, on publiait des photos du cadavre d’un enfant. Avant, lors d’un crime d’enfant, il y avait au mieux une photo carrée en noir et blanc prise dans un photomaton ou une photo floue en couleur tirée d’un album de famille.

Qu’est-ce que vous pensez du fait divers en presse écrite aujourd’hui, sachant qu’il doit s’adapter à une concurrence nouvelle, celle des chaînes d’info en continu et des réseaux sociaux ?
L. L. Cet apport du web et des réseaux sociaux fixe sur un écran ce que moi j’ai vécu en direct. On dit toujours que c’est pire [avec les nouvelles technologies, NDLR], je ne sais pas à vrai dire. Partout où nous allions, les gens nous agressaient sur l’affaire Grégory, déversaient des tombereaux de haine sur Christine Villemin qui a été leur cible pendant des années. Elle a reçu des milliers de lettres, certaines souillées avec des excréments. Mais si les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, et que ça avait aimanté toute cette haine, Christine Villemin aurait pu s’en protéger, parce qu’on n’est pas obligé d’être sur les réseaux sociaux. Alors que les lettres, elle était forcée de les recevoir. Les regards dans la rue aussi, elle ne pouvait les éviter.
La grande différence avec cette période c’est surtout le tout-info. On mouline à longueur de journée et moi ça me fait très peur. Qu’ils s’appellent Jacob, Bolle ou autre, avoir sa photo qui passe dix fois, vingt fois dans une heure, c’est terrible et préjudiciable. Un exemple : le jour-même où le juge Lambert s’est suicidé, en juillet 2017, les carnets du magistrat Maurice Simon ont été divulgués sur BFM-TV. Toute la journée, le présentateur a laissé entendre, sans le dire, que c’était moi qui avait livré ces carnets. C’est faux. J’ai fait alors savoir qu’il fallait arrêter de diffuser cette information. J’ai une très piètre estime de cette forme de journalisme qui façonne une forme de piétinement intellectuel. Si j’ai refusé la plupart des interviews depuis la réouverture de l’affaire, c’est parce que je voulais me protéger car je craignais de me retrouver projetée trente-quatre ans en arrière avec des gens qui disent tout et n’importe quoi. Cette époque-là est morte pour moi. Peut-être qu’un jour, si tout est clair, je pourrai m’exprimer pour dire des choses que je n’ai pas dites aujourd’hui. Mais pas te pour refaire l’histoire.
A Nantes, tournée avec une fait-diversière
En presse régionale, le fait divers est une spécialité que les rédactions tiennent à préserver. Isabelle Labarre est l’une de ces spécialistes à Ouest-France Nantes. Même si elle est désormais obligée de s’adapter aux nouvelles exigences de réactivité, la journaliste mène encore ses enquêtes avec les méthodes d’investigation traditionnelles.

Faire face à la concurrence même en locale
Dans le hall d’entrée du commissariat, des badauds patientent dans une file d’attente qui ne cesse de s’allonger. Une femme hurle qu’elle souhaite porter plainte. Des policiers courent d’un bureau à l’autre. Peut-être n’ont-ils pas encore aperçu les journalistes, qui eux aussi, prennent leur mal en patience.
Ouest-France et le concurrent local, Presse Océan, viennent chaque matin glaner les informations du jour auprès du commandant de police. Le bulletin du jour fait entre autres état d’un échange de coups de feu dans un quartier sensible de Nantes, à Malakoff, et qui a fait un blessé grave. La synthèse du rapporteur de la police s’en tient à quelques déclarations laconiques qui n’apprennent finalement rien sur les circonstances de ces échanges de tirs.
Retour dans la voiture. Isabelle Labarre décide d’en savoir plus et de se rendre sur place. Sur la route, un coup de fil. Une source privée, que la journaliste tient à protéger notamment vis-à-vis de son principal concurrent, vient de la contacter. Elle en sait désormais plus sur le profil du blessé. Elle en profite pour appeler une de ses collègues au desk web de la rédaction afin d’écrire au plus vite un « DMA » (dernière minute d’actualité). Entre deux feux rouges, elle dicte un article qu’elle rédige au fur et à mesure dans sa tête. L’article, auquel se greffera une alerte, paraîtra sur le site dans quelques minutes.
Le terrain, clé de voute du métier
Isabelle Labarre le complètera par les dernières informations qu’elle espère obtenir dans le quartier où a eu lieu l’agression. Pas de temps à perdre, cinq minutes plus tard, elle arrive au pied des tours HLM de la cité Malakoff. Celle-ci est réputée pour ses tensions liées aux trafics de drogues et à la circulation d’armes.
Quelques habitants se sont aventurés sous la pluie battante mêlée à un vent frais. Ils répondent sans difficulté aux questions de la journaliste et confient leur lassitude de voir la réputation de leur quartier salie par ces « voyous », disent-ils. Un père de famille déclare avoir eu peur pour ses enfants qui jouaient devant l’immeuble quand les coups de feu sont partis. Un règlement de compte inter-quartier semble-t-il.
D’autres prennent la journaliste à partie : « Pourquoi vous nous rendez visite dans ces circonstances-là et pas pour des informations valorisantes pour notre quartier ? » « Et le supermarché qui vient de fermer, vous n’en parlez pas ? » Un refrain que la journaliste, qui doit composer entre les différents intérêts locaux, connaît bien. Il est presque midi quand elle rentre à la rédaction, assez tôt pour appeler ses derniers interlocuteurs, la police judiciaire, et finir son article.
A 16 heures, elle se dépêchera vers un autre rendez-vous quotidien : le point presse avec le parquet.
Il était une fois un crime
S’il gagne difficilement la France, le podcast autour du fait divers est devenu le nouveau phénomène tendance dans la culture anglo-saxonne. Une recette qui ne date pas d’hier mais qui s’inscrit dans les canaux modernes.
Il faut dire que tous les ingrédients sont là pour rendre accro l’auditeur. Dès l’ouverture de S-Town, la voix irrésistible de John B. McLemore, le principal protagoniste, crépite dans la ligne téléphonique : celui-ci demande aux journalistes, créateurs de la série, d’enquêter sur un meurtre présumé dans la ville de Woodstock.
En figurant parmi les dix meilleurs podcasts sur iTunes au Royaume-Uni, la série criminelle Casefile bat tous les records et tend également à populariser le format du podcast. L’auteur, anonyme, a choisi des sujets réels comme les meurtres de Daniel Morcombe et le massacre de Port Arthur et est ainsi parvenu à marier l’investigation journalistique au récit. Cette formule très populaire dans le monde anglo-saxon a un nom : le true-crime. Il s’agit en fait d’histoires, souvent racontées dans des formats cinématographiques ou radiophoniques, visant à retracer un fait divers marquant. Parfois, certains réalisateurs admettent plus ou moins une part d’invention dans la reconstitution des évènements. L’incarnation et la narration des faits sont l’ADN même du true crime, qui n’est pas un simple documentaire exposant des faits mais une histoire romancée. Il rappelle la vision américaine du journalisme proche du storytelling. Et il reprend énormément de codes récents des séries Netflix.
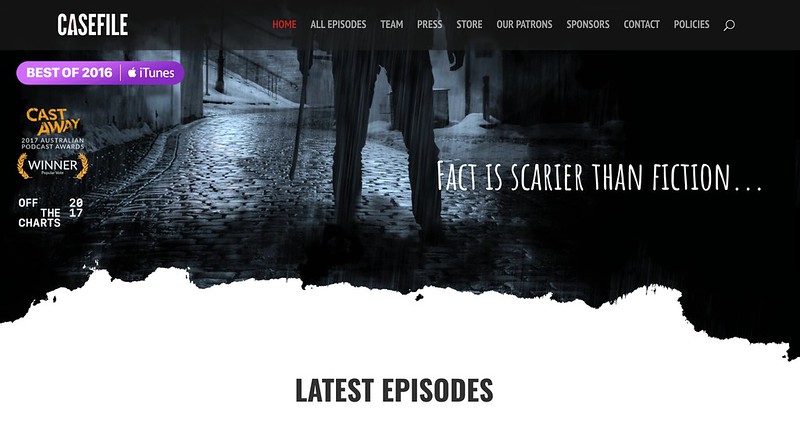
Le terme « fait divers » apparaît d’ailleurs dans la langue française en 1838, introduit par le romancier Théophile Gauthier et désigné comme « une nouvelle ponctuelle concernant des faits non caractérisés par leur appartenance à un genre (…), souvent dans un domaine délictueux ou criminel ».
Qu’ils soient écrits (Les Jours) ou oraux (S-Town, Casefile), ces épisodes qui réactivent l’engouement pour le fait divers, restaurent ce qui fit la fortune de la presse au XIXe et au XXe siècle : des feuilletons sur des faits divers mythiques comme l’affaire Troppmann ou l’Affaire Lerouge.
Pour aller plus loin…
Bibliographie
- DUBIED Annik, Le fait divers, collection « Que sais-je ? », ed. PUF, 1999, 128 pages.
- DELIEZ Nicolas, Le journaliste et les criminels : dans les coulisses du fait divers, Lemieux
éditeur, Mundo médias, 2016, 380 pages. - PLENEL Edwy, Un temps de chien, éd. Stock, 1994, 192 pages.
- Society Hors série (Fait divers), « Crime », juillet 2017
Articles
- ROUSSEAUX François, « Le fait divers fait monter l’Audimat », Le Monde, 2 février 2018
- GRASSIN Sophie, « Ivan Jablonka : Un fait divers est une construction médiatique »,
L’Obs (Le grand oral), 17 février 2018 - FAURE Sonia, « Mara Goyet : Le fait divers, boule à neige de l’horreur », Libération, 8
mai 2016
Émissions de radio
- France Culture, « Faits divers : quel traitement journalistique ? » dans le Secret des sources
avec Frédéric Barreyre, 1er novembre 2014 - RTL, « Sous le charme du fait divers » dans L’heure du crime avec Jacques Pradel, 6 mai
2016 - France Inter, « Pourquoi les faits divers nous fascinent-ils (ou pas ?) », Ça va pas la tête !,
29 juillet 2016
Émission de télé
- Vosges Télévision, « Justice et médias : quelles relations ? », La thématique, 29 mars 2018

Clotilde Costil
23 ans
@ClotildeCostil
En licence pro presse écrite et en ligne à l’EPJT.
Passée par La Vie, La Croix, Paris Match ou encore Le Figaro.
Intéressée par le journalisme social,
elle se destine à la presse magazine
ou à la presse quotidienne nationale.
