En terre ultra
La saison de foot vient de recommencer pour le plus grand bonheur des ultras. Ces supporters d’un genre particulier ne vivent que pour une chose : leur club. Plongée dans un mode de vie peu connu et pourtant souvent mal jugé.
Par Thibaut Alrivie, Antonin Deslandes, Christophe Magat, Simon Soubieux et Robin Wattraint
Dimanche 11 décembre 2016, c’est un grand soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, troisième de Ligue 1, accueille l’OGC Nice, leader. Pour ce match à enjeu, le CUP s’est affairé toute la semaine, jusqu’aux dernières heures. Pour être à la hauteur. A l’entrée des joueurs sur le terrain, toute la tribune est concentrée pour déployer son tifo. « Ceux qui ont du rouge sur leur feuille, vous montrez le rouge. Les autres, vous montrez le côté argenté », ordonne le capo à plusieurs reprises. Le résultat n’est pas parfait. Mais la tribune se rattrapera sur les chants.
Au retour des vestiaires, Edinson Cavani redonne de l’espoir à Paris en réduisant l’écart. Puis l’Uruguayen égalise à l’heure de jeu. Un scénario qui promet une dernière demi-heure de folie. Plus la fin du match approche, plus la tribune s’égosille. « Allez les gars ! Il ne reste plus beaucoup de temps, on va pousser l’équipe. C’est à nous de jouer ! Allez les bras ! Les bras ! » hurle le capo à dix minutes du terme. Les quelque deux cents ultras de la tribune, bien organisés, embarquent avec eux tout le virage. Malheureusement pour les supporters parisiens, ce soir-là, cela ne suffira pas pour que les joueurs marquent le troisième but synonyme de succès.

Nice reste en tête du championnat. Mais la joie d’investir à nouveau le Parc des Princes finit par prendre le dessus. Cela fait un peu plus de deux mois que les ultras parisiens ont le droit de revenir au stade. « On savoure, vraiment, confie Florian. Notre plaisir, c’est d’être là alors qu’on nous avait dit “Vous ne reviendrez jamais”. » Et avec eux, c’est l’âme du Parc qui revient petit à petit.
Dans le paysage du foot français, les ultras sont à part. Ils sont quelques milliers à travers l’Hexagone, que beaucoup regardent de loin, sans vraiment les comprendre. « Il y a plusieurs manières d’être supporter, détaille le sociologue Nicolas Hourcade, spécialiste du « supportérisme ». Un ultra, c’est quelqu’un qui veut être un ultra, qui veut s’engager dans ce style de supportérisme particulier. » Pour la définition, difficile d’aller au delà de cette tautologie. Ceux qui se considèrent comme tels se reconnaissent dans certaines valeurs. Et leur investissement pour leur club est sans faille. Hugues, membre des Ultramarines de Bordeaux, tente de résumer la chose : « On est davantage passionnés que les autres supporters. On a envie de l’extérioriser davantage, de le montrer plus fort. » Les résultats passent au second plan. « Le plus important pour moi, c’est la manière dont se comporte le groupe en tribune », ajoute-t-il
Une vocation qui, souvent, se dessine dès les premières visites au stade. « Gamins, on a tous eu envie de participer, se rappelle Romain. D’être dans le cœur, dans le poumon du stade. » Comprenez avec les ultras. Aucun n’imagine vivre un match autrement que debout, à chanter pendant quatre-vingt-dix minutes. Une manière d’être que certains reconnaissent volontiers excessive par moments, mais indispensable. Et qui s’acquiert au fil des années.
Famille
Chez les ultras, il n’y a qu’une seule priorité : le club. Quelle que soit la ville, quelle que soit l’équipe. Le lien est trop fort pour qu’il en soit autrement. Au fil de la discussion avec Mika, c’est même une déclaration d’amour qui prend forme. « C’est difficile à expliquer, encore plus à faire comprendre. Allez expliquer pourquoi vous aimez votre femme. Ce n’est pas facile. Bah là, c’est pareil. Trouver les mots pour expliquer un amour fou, c’est complexe. »
Sainté vit pour son club. Avec une communauté exceptionnelle, celle du « peuple vert » (de la couleur des maillots de l’équipe) et de ses valeurs. « Quand on arrive à Saint-Etienne, on est toujours surpris. La ville est un peu triste, elle est pleine de clichés, résume Patrick Guillou, joueur de l’ASSE entre 1997 et 2000. Mais quand on voit la chaleur qu’il y a dans le cœur des supporters, on en est changé. En tant que joueur de foot mais, surtout, en tant qu’homme. » Être joueur de Saint-Etienne marque une vie. Pénétrer dans Geoffroy-Guichard avec le maillot vert aussi.
Le stade est le poumon de la ville comme nulle part ailleurs. « Le foot, il n’y a que ça à Saint-Etienne, témoigne Julien Sablé, ancien capitaine emblématique des Verts. Le terrain vibre quand ça pousse. Ça chante de la première à la dernière minute. Dans les temps forts d’un match, ça redonne de l’énergie. Quand tu es au bout de tes forces, ça te booste et ça te permet d’aller puiser dans des réserves que tu ne soupçonnais même pas. »
Dans les tribunes, les ultras stéphanois défendent des valeurs de travail et d’humilité. « Ils veulent des équipes engagées et concernées. Ils n’ont jamais aimé le bling-bling », se souvient Julien Sablé. Et pas trop les projecteurs ni les journalistes : Magic Fans et Green Angels, les deux groupes stéphanois, n’ont pas souhaité nous rencontrer.
L’image est secondaire. Seul l’ASSE compte. Julien Sablé reprend : « La première chose que l’on m’a apprise ici, c’est qu’il faut mouiller le maillot. C’est une valeur très importante pour eux. Il faut toujours croire en soi et se battre jusqu’au bout quel que soit le résultat. Ils aiment le courage. » « J’allais souvent les rejoindre dans leur local. J’ai découvert une famille, ajoute Patrick Guillou. Un lien fort relie tous les membres qui leur permet de franchir les coups durs de la vie, comme les décès, les maladies, le chômage.

Être ultra ne se limite donc pas aux actions menées pour son club. C’est une philosophie qui mène certains groupes à des actes de solidarité forts, comme les Ultramarines, à Bordeaux. « Nous accueillons des jeunes qui n’arrivent pas à donner un sens à leur vie. Notre rôle est de leur montrer qu’ils ont de l’importance, ça peut leur éviter de faire des conneries », estime Casti. Les Ultramarines s’impliquent également dans des associations caritatives.
Récemment, ils ont invité des réfugiés sahraouis à assister à un match après avoir effectué une collecte de vêtements. Ils participent aussi régulièrement à des collectes de jouets pour les hôpitaux de Bordeaux. « On ne cherche pas à avoir une médaille ni à se faire bien voir. Ce sont simplement des valeurs d’entraide que l’on défend et que l’on essaie au maximum de développer, car la société n’est pas comme ça aujourd’hui, regrette Casti. On n’a pas la prétention de changer le monde mais on est heureux d’améliorer le quotidien des personnes qui en ont besoin. »
Un ensemble de valeurs qui mène inéluctablement à la politisation. D’extrême gauche ou d’extrême droite, jusqu’aux années quatre-vingt, les ultras revendiquaient une appartenance. Puis ils ont petit à petit préféré se dire apolitiques, dans un souci de communication. Ce qui n’empêche pas la politique, par moments, de reprendre le pas sur le football.
Novembre 2016, stade Jean-Bouin, 16e arrondissement de Paris. Le Red Star est mené à domicile contre Troyes quand, dans les dernières minutes du match, l’arbitre siffle une faute litigieuse en faveur des visiteurs. Les ultras du Red Star, frustrés par le score, sautent sur l’occasion. Le chant emblématique du club retentit : « Flic, arbitre ou militaire, qu’est-ce qu’on ferait pas pour un salaire ! » « C’est un chant antiflic, assume Maud Valegeas, ultra du Red Star. Traditionnellement, entre flics et supporters du Red Star, ce n’est pas le grand amour. »
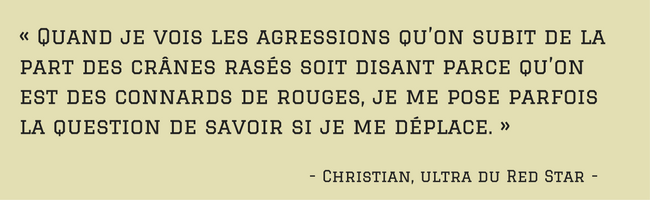
A Saint-Ouen, on assume : être ultra, c’est un acte militant. « Le Red Star, ça représente tout ce qu’on défend politiquement, explique Maud. L’anticapitalisme, le féminisme et la lutte contre le fascisme. » L’héritage de Rino Della Negra, ancien membre du groupe Manouchian et supporter du club du 93, est omniprésent. Maud ajoute une anecdote qui en dit long : « La légende dit que les vestiaires du stade Bauer servaient de cachette aux résistants communistes pendant l’occupation. C’est une histoire qui se transmet de supporter en supporter. »
Dans les tribunes du « Red », la politisation n’est pas un tabou. « Tout est politique. Quand on défend une équipe, quand on défend ses couleurs, on défend un projet de société. C’est ça aussi, un club de supporters : un endroit où on est solidaire et avec tout le monde. Pas comme le font les ultras d’extrême droite, qui ne sont solidaires qu’avec les hommes blancs. »
Même pour les « autres » spectateurs, ceux qui ne sont pas membres des ultras, cet aspect saute au visage. Nicolas Hourcade se souvient d’un match entre le Red Star et le Tours FC, à l’automne 2016. « J’étais dans les gradins avec les supporters du Red Star. C’est une tribune où les slogans politiques sont fréquents. Mais là, recevant Tours, dont certaines franges des ultras sont d’extrême droite, il y a eu une rhétorique antifasciste très forte. »
Pour une partie du groupe, le stade devient ainsi un terrain de lutte. « On occupe l’espace avec nos idées et on empêche que l’extrême droite s’y impose, clame Maud sans se dérober. Les groupes néonazis sont très représentés chez les ultras. C’est le cas à Tours, à Orléans. A Strasbourg aussi, il y a régulièrement des insultes et des bagarres. »
Mais cette politisation n’est pas bien vécue par tous. Christian est devenu supporter du Red Star en 1968. Depuis, lui et son écharpe rouge et verte sont de tous les matchs. « En 1968, les tribunes n’étaient pas politisées. On était très loin de ce qu’on peut voir aujourd’hui, où chaque groupe d’ultras a une étiquette. »
Le sexagénaire a longtemps refusé de voir de la politique au stade, mais il s’y est trouvé confronté lors des déplacements de son équipe. Le club, qui arbore sur son logo une étoile rouge, ne peut pas se défaire de son image gauchiste. « Quand cette étiquette n’est pas appréciée, on peut subir de graves incidents, regrette-t-il. On peut se faire agresser, soit disant parce qu’on représente l’antifascisme. »
Alors aussi politisés soient-ils, les ultras du « Red » doivent s’adapter. « Clairement, quand on se déplace, on n’affiche pas les couleurs du Red Star dans la rue, confie Christian. On planque les bâches. »
On évoque alors, par exemple, les ultras du Tours FC. Silence de quelques secondes. Puis Christian reprend : « Et alors quoi ? On va dire que tous les Tourangeaux sont des fachos ? Moi j’ai plein d’amis tourangeaux, ils ne sont pas fachos. Sauf qu’il y a deux cents gugusses qui se revendiquent d’extrême droite et qui foutent le bordel dans la tribune. A Strasbourg, pareil. J’aime bien, moi, les Strasbourgeois. Ce sont des amis, pour certains. Sauf que dans la tribune, on se fait agresser. On va à Metz, c’est pareil. A Nancy, c’est pareil. On nous prend pour ce qu’on n’est pas. » Christian est désormais habitué. Pour lui, même s’il n’en veut pas, ce sera l’étiquette « Coco » ou « Rouge ». L’étiquette communiste.
Aux origines
Au quatrième étage du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille, le bureau de Florent Molle regorge de trésors. Conservateur du patrimoine, responsable du pôle « Sport et santé », il a arpenté l’Europe et les contrées limitrophes, allant à la rencontre des groupes ultras et collectant objets insolites et souvenirs. Un échantillon alimentera l’exposition « Nous sommes foot » en octobre prochain au Mucem.
« Quand on parle aux ultras de la conservation de leur mémoire, c’est quelque chose qui les intéresse », explique Florent Molle. Sauvegarder leur histoire est d’autant plus important qu’en plus de trente ans d’existence, ils ont connu bien des chamboulements. Dans leurs rapports avec les pouvoirs publics, mais aussi en leur sein, avec l’arrivée de nouvelles générations.
Un peu plus de dix ans après l’émergence de la première association de supporters, le Club Central des Supporters (CCS), la cité phocéenne devient le berceau du mouvement en 1984. L’implantation du Commando Ultra dans les tribunes du Vélodrome devient un terreau propice à la création d’autres collectifs. Les South Winners, les Yankees et les Fanatics voient le jour avant le début des années quatre-vingt-dix, suivis des Dodger’s en 1992 et des MTP (Marseille Trop Puissant) en 1994.
Le CU84 lance des quêtes dans les virages, les facs et les lycées pour se financer. Les premières bâches et écharpes voient le jour. Des débuts parfois compliqués, où l’investissement personnel et la débrouille dominent. « On récupérait des torches d’alarme périmées des bateaux en guise de fumigènes, ou dans des michelines de la SNCF visitées la nuit », raconte un membre de la Vieille Garde. Petit à petit, le groupe se structure et séduit de jeunes supporters fascinés par l’énergie naissante qui émane du mouvement ultra.
Dans les travées, ce folklore déplaît. Des supporters voient d’un mauvais œil ces jeunes qui vivent le match debout, qui sont davantage acteurs que spectateurs du match. « La tragédie du Heysel survient quelques mois après la naissance du Commando Ultra. Ça a contribué à ce sentiment d’hostilité, déplore La Vieille Garde. Les abonnés du quart de virage ont même fait une pétition pour demander notre interdiction en 1985. »
Du côté de Nice, Frédéric Braquet, président de la tribune Populaire Sud jusqu’en 2016, revient sur ce passé flamboyant. « Dans ma jeunesse, quand on allumait un fumigène, ça s’inscrivait dans l’ambiance du stade. Maintenant, on ferme des tribunes pour ça. C’était une époque totalement différente. Quand on faisait une connerie, on ne se faisait pas embarquer, on était relâché. »
La modernisation du football a fait naître des dynamiques nouvelles en tribune. Pour beaucoup d’ultras, les stades flambant neufs vont à l’encontre de la passion populaire. L’OGC Nice est l’exemple typique de ces maux qui traversent le « supportérisme » européen. « Le Ray, c’était un stade qui respirait le vrai football. Pour moi, ça rimait avec “pas d’interdiction, pas de restriction’’. C’était un football moins propre, avec des tribunes en béton », se rappelle Frédéric. A l’époque, certains groupes visiteurs pointaient du doigt le nombre de places (17 000). Ce sont les mêmes qui, aujourd’hui, regrettent l’ambiance du Ray lorsqu’ils se déplacent à l’Allianz-Riviera, le nouveau stade des Niçois.

A Marseille, les années passent mais la ferveur reste la même. L’agrandissement du stade Vélodrome n’a pas changé la donne et les différentes présidences qui se sont succédé ont toujours su préserver le mouvement ultra olympien. Depuis l’ère Tapie jusqu’à l’été 2015, ce sont les ultras qui géraient les abonnements. Certains groupes obligeaient même à prendre une carte pour pouvoir accéder au virage, preuve de la volonté du mouvement marseillais de perpétuer une certaine tradition et de ne compter dans ses rangs que les mordus de l’OM.
D’un autre côté, cela démontre aussi l’influence des groupes ultras au sein même de l’institution. « Les groupes ont réussi à imposer leur vision populaire du match de foot dans le paysage du club, expliquent les membres de la Vieille Garde. Grâce à ça, les prix des places n’ont quasiment pas augmenté et la nouvelle direction continue à maintenir le caractère populaire et fervent du supportérisme marseillais. »
Quelque chose à changer ? « La répression. L’époque où on débarquait à plusieurs centaines de milliers en déplacement sans escorte est révolue », regrettent les fondateurs du CU84. Même si le nombre d’interdictions de stade est en baisse par rapport à 2009, année à laquelle la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) est créée, les autorités trouvent d’autres façons de sévir.
« Les autorités ont retracé leur parcours et sont remontées jusqu’à mon restau. C’est à partir de ce moment que j’ai dit stop à la présidence. Je sentais que j’étais dans le collimateur, quoi que je fasse », fulmine-t-il.

Ce ne sera pas pour cette fois. Et le challenge le plus important qui attend les ultras est sans doute la transition générationnelle. Jeunes adultes lors de l’arrivée du mouvement en France, c’est d’un œil critique que les plus anciens voient arriver les nouvelles générations. Frédéric Braquet soupire : « J’ai 42 ans, une famille, j’ai beaucoup donné. La génération qui arrive est têtue. On a des codes différents, c’est pas simple de gérer ça. » Les plus jeunes apportent de nouvelles positions auxquelles n’adhèrent pas toujours les anciens.
C’est le cas pour le ACAB (All Cops are Bastards. En français : tous les flics sont des salauds). Un précepte que la répression aux abords des stades a fait naître progressivement. Si les plus anciens ne cautionnent pas la recherche de l’affrontement avec les forces de l’ordre, ils ont conscience des difficultés que rencontrent les nouvelles générations dans le climat actuel.
« Ils ont du courage de se revendiquer ultras dans ces conditions », concèdent les membres de la Vieille Garde, tout en cadrant les jeunes supporters sur le comportement à avoir dans l’enceinte. « Gare à la dérive du foot vécu par procuration, Smartphone en main et dans un stade rempli d’antennes wifi. »
Obligation également de laisser les survêtements aux couleurs d’autres équipes à la maison. A Marseille, on ne vit qu’avec du bleu et blanc et les groupes ultras l’ont déjà fait savoir en placardant un message explicite dans les travées : « Survets et maillots de l’OM et basta ! La passion ne s’achète pas ! Arrête de filmer et chante avec la foi pour de vrai ! » Ça a le mérite d’être clair : faire respecter les traditions et transmettre les valeurs est aujourd’hui un des enjeux majeurs du mouvement ultra.
Contre-pouvoir
La dégradation des relations entre le club nantais et ses ultras n’est pas récente. « On n’a plus de dialogue depuis trois ans, regrette le président du FC Nantes, Waldemar Kita. La dernière fois qu’on a discuté, la Brigade Loire était venue nous voir en reconnaissant qu’on avait fait du bon travail. On avait même bu une coupe de champagne ensemble. Mais dès le week-end qui a suivi, ils n’ont rien respecté de ce qu’on s’était dit et ont continué à taper sur le club. Les ultras n’ont pas été honnêtes, ils nous ont trahi. » Entre la direction et ses ultras, on ne se comprend plus et on ne s’écoute plus. Le divorce est consommé.
Le départ de l’entraîneur Michel Der Zakarian à l’issue de la saison 2015-2016 a envenimé la situation. Il a claqué la porte suite à des désaccords avec le président Waldemar Kita, au plus grand désarroi des supporters nantais. Son remplacement par René Girard ne passe pas. Une pétition réclamant le départ de ce dernier circule très vite sur Internet. Puis, avec les mauvais résultats de l’équipe, les premiers chants contestataires descendent des tribunes. Ils renaissent à chaque match.
« La légitimité des ultras vient de leur nombre, de leur importance en tribune, mais également de leur mobilisation derrière le club, justifie Nicolas Hourcade. Souvent, l’argument qu’ils mettent en avant, c’est celui de leur présence permanente. Ils se voient comme les garants de l’histoire et du bon fonctionnement du club. Ils se servent du soutien qu’ils apportent pour faire pression. » Et quand les mauvais résultats se succèdent, la pression s’accentue. François Clerc, ancien joueur de Nice, s’en souvient : « A chaud, parfois, ils ne rendaient pas forcément service à l’équipe. Mais d’un autre côté, avoir des ultras qui montrent leur mécontentement aide les joueurs à se bouger. »
A Nantes, le président reste de marbre : « Les attaques contre moi ? Je suis très indifférent. Après dix ans à me faire insulter, je ne fais plus attention. Cela me touchait les premières années. Aujourd’hui, j’arrive à passer au-dessus. Ça me motive même plus qu’autre chose. »
Sur le terrain, le niveau technique n’est pas au rendez-vous. Et les supporters le font savoir. « On se fait chier, on se fait chier », entonnent-ils à l’unisson. Mais l’affrontement entre La Brigade Loire et les dirigeants du club ne se limite pas aux chants et aux invectives depuis les tribunes. Ça peut aller beaucoup plus loin.
Lors d’un match contre Toulouse à la Beaujoire, des ultras tentent de pénétrer dans la loge de Waldemar Kita. A d’autres occasions, ils assurent vouloir trancher la tête de leur président. « Je serais partisan du partage des opinions, mais sans agressivité, réagit Kita. Il ne faut pas que les ultras menacent de me tuer ou de me couper la gorge. Bien sûr qu’il faut partager les points de vue, mais c’est normal de fermer la porte quand on se fait insulter. »
En juste retour de bâton, le FC Nantes restreint les conditions de déplacement des supporters et interdit toutes banderoles et mégaphones dans son stade, creusant un peu plus le fossé entre les deux camps. Plusieurs membres de la Brigade Loire sont même visés par une interdiction de stade. « La situation est désormais très claire, déclarent alors, dans un communiqué, les ultras. Les dirigeants du FC Nantes et les autorités ont fait le choix commun de se débarrasser de la Brigade Loire. » Nous avons contacté le responsable du groupe, Romain Gaudin. Il n’a pas souhaité répondre à nos questions, malgré nos très nombreuses sollicitations. Sujet sensible.
« Je suis prêt à faire beaucoup de choses mais pas à aller à une réunion pour me faire insulter. La Brigade Loire doit changer de stratégie, poursuit Waldemar Kita. Parfois, on dirait que le club appartient à tout le monde. Mais il y a un propriétaire qui prend les décisions. » Le message est clair, la direction ne veut pas céder au chantage. Pourtant, en décembre 2016, le FC Nantes annonce bien le départ de son entraîneur René Girard.
Le président nantais refuse de reconnaître que les ultras ont influencé cette décision. « Je pensais qu’il était la meilleure solution. Mais après il suffit de quelques détails en match, un poteau, une barre, pour que ça aille dans le mauvais sens. A la fin, c’est René qui est parti de lui-même. Pour le bien du club. Et c’est tout à son honneur. » « C’est toujours compliqué quand les ultras demandent une démission, la situation est tendue, pointe de son côté François Clerc. Ils ont un certain pouvoir populaire, comme des électeurs. Ils peuvent faire basculer des décisions. Ou du moins faire en sorte que certaines décisions soient prises plus rapidement. »
Toujours est-il que pour le bien du FC Nantes, la direction doit trouver rapidement une issue à ce conflit. Elle a besoin de la Brigade Loire pour animer les tribunes. « Les clubs sont conscients qu’ils ne peuvent pas se passer des ultras, même s’ils les trouvent incontrôlables. Ils créent l’ambiance et la ferveur indispensables à un match de football. Ils ont besoin de ce douzième homme dans les tribunes. Cela leur apporte beaucoup », estime Nicolas Hourcade. Le poids des ultras au sein d’un club n’est pas négligeable.
« Cela nous permet d’agir et d’interférer dans la vie quotidienne du club, soit concernant les résultats, soit quelque chose d’autre qui se passe dans le club, se réjouit Romain, un responsable des Ultramarines de Bordeaux. Il y a des choses que nous, nous pouvons nous permettre de faire ou de dire et que les dirigeants du club ne peuvent pas faire. Il y a eu des périodes où le club était dans une situation où plus personne n’était en capacité d’interférer au sein de l’effectif, au sein du club et de la direction. Il ne restait plus que nous. A un moment donné, si personne ne peut remuer la merde, nous prenons en charge cette partie là. » Comme pour l’affaire André Poko.
Les Ultramarines ont fait le déplacement. Ils sont décidés. Décidés à faire entendre leur voix au nom de l’ensemble des supporters girondins. Ils patientent quinze petites minutes, tranquillement. Puis interrompent la séance d’entraînement. La raison ? Une photo publiée sur Snapchat par André Poko, dans laquelle le joueur se met en scène fumant la chicha, un maillot de l’Olympique de Marseille sur le dos. Une trahison pour les ultras bordelais, historiquement hostiles au club olympien depuis l’affrontement Claude Bez/Bernard Tapie dans les années quatre-vingt.
Quelques jours plus tard, le joueur est transféré en Turquie, au Kardemir Karabukspor. « Les ultras ont joué un rôle dans son départ, c’est certain, reconnaît Jean-Louis Triaud, ancien président des Girondins de Bordeaux. Mais si André Poko est parti, ce n’est pas parce que les ultras de Bordeaux l’ont demandé. C’est parce que moi, j’ai jugé que ce n’était plus possible pour lui de rester dans ces conditions. »
Sauf que dans ces « conditions », il y a la grogne des ultras.

Les Ultramarines, dans cette affaire, ont donc réussi à marquer leur territoire. « Nous veillons à la bonne santé du club, résume Casti, un autre membre actif. Il était là avant nous. On joue notre rôle pour défendre l’histoire et les couleurs des Girondins. Toutes nos actions sont réalisées dans l’intérêt du club. » Jean-Louis Triaud préfère, lui, relativiser les relations entre direction et ultras. « C’est un peu comme dans une entreprise avec le patronat et les syndicats. Les rapports sont plus ou moins conflictuels mais on s’assoit toujours autour de la table pour discuter. »
Car, à Bordeaux comme dans d’autres clubs, le dialogue est très présent. « Nous avons des relations permanentes. Chez nous, des personnes sont chargées de faire le lien et d’entretenir le contact direct avec les ultras, et ce toute l’année », explique Jean-Louis Triaud. En vingt ans de présidence, il a eu le temps d’apprendre à connaître les membres actifs et les dirigeants des Ultramarines. « On ne peut pas dire qu’on a toujours été d’accord. Il y a eu des moments de tension, mais nous avons réussi à maintenir des relations constructives. »
D’un côté, les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs ne détiennent pas toujours la vérité. De l’autre, les ultras ont besoin d’être mis devant certaines réalités du football. « La communication, c’est de cette manière qu’on avance, garantit l’ancien capitaine des Verts. Il faut ressortir de nos échanges en nous disant que nous sommes unis, que nous avons trouvé un compromis entre toutes les parties et que le week-end suivant nous serons tous ensemble pour affronter le prochain adversaire. »
Les ultras ont besoin d’être intégré au projet. Ne serait-ce qu’en guise de remerciement pour leur infaillible soutien.
Déracinés
Parfois, l’amour du maillot n’est pas payé en retour. Les ultras se sentent alors abandonnés par un club auquel ils ont tout donné. De quoi laisser un goût amer. A quelques dizaines de kilomètres au nord de la capitale, les ultras du Red Star vivent depuis bientôt deux ans un douloureux chemin de croix.
Avec la montée de leur club en Ligue 2, le mythique stade Bauer, enceinte historique où le club de Saint-Ouen évoluait depuis 1909 presque sans discontinuité, a été abandonné car non-homologué. Le football moderne et ses normes passent avant l’histoire, les traditions et les sentiments. Le Red Star a dû s’expatrier loin de ses bases, d’abord à Beauvais pour la saison 2015-2016, puis à Jean-Bouin pour 2016-2017.
Aujourd’hui, Bauer est donc bien vide. Seules les équipes de jeunes y jouent encore. Alors, quand il évoque le stade, Christian, fidèle du Red Star depuis bientôt cinquante ans, veut se souvenir de tous les détails : « Bauer, c’est déjà l’arrivée rue du Docteur-Bauer, puis l’Olympic, le bar où on va boire une bière avec ses potes. J’ai plein d’images en tête de gens, devant le stade, en train de parler de tout et de rien. Ensuite on entre, on passe des portillons qui n’en sont pas. On scanne les tickets et on accède aux tribunes. Il n’y a pas de places numérotées, pas de sièges. C’est du béton. C’est ça Bauer. C’est la chaleur humaine, ce côté “Je suis chez moi”. »
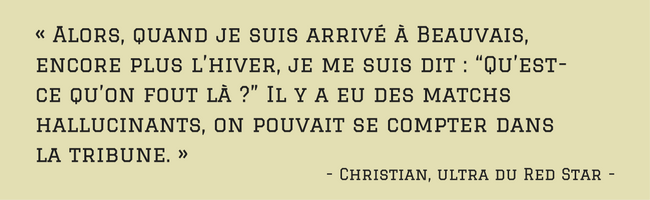
Quand Christian et tous les ultras comprennent que l’équipe ne jouera plus à Bauer, c’est la douche froide. Ils ne veulent pas y croire. Jusqu’au dernier match, où il leur faut se rendre à l’évidence. « Ce soir- là, on n’a pas lâché une larme parce qu’on est des grands garçons. Mais quelque part, ça nous a fait mal. On savait qu’en allant à l’Olympic, en face du stade, ce serait notre dernière bière ici. On était assommés, c’était un coup de massue sur la tête de tout le monde. On nous a tous tués. »
C’est ce qui rend aujourd’hui nostalgique tous les ultras du club de Saint-Ouen. Une toiture métallique qui résonne au rythme des chants, des tribunes à l’anglaise, à quelques centimètres de la ligne de touche et une explosion à chaque but : impossible de vivre ça ailleurs. « C’est une deuxième maison », avoue Christian à mi-voix. Le sexagénaire refuse d’ailleurs de parler au passé parce qu’il espère secrètement retrouver un jour le Bauer qu’il aimait.
Mais pour le moment, il n’a pas d’autre choix que d’aller à l’autre bout de la région – voire même plus loin. La saison dernière, contrairement à une partie des ultras qui ont voulu boycotter le déménagement à Beauvais, Christian s’est déplacé. Pour l’équipe, mais presque à contrecœur. « On nous a enlevé notre âme. Bauer, c’était l’identité du club, c’est là que tout a eu lieu. Alors, quand je suis arrivé à Beauvais, encore plus l’hiver, je me suis dit : “Qu’est-ce qu’on fout là ?” Il y a eu des matchs hallucinants, on pouvait se compter dans la tribune. »
A la fin d’une saison sportivement réussie, les espoirs renaissent. Si le club gagne en visibilité, pourquoi ne pas faire les travaux nécessaires pour réhabiliter Bauer ? Il n’en sera rien. Le retour en Île-de-France a bien lieu, mais pas à Saint-Ouen. Le Red Star s’installe à Jean-Bouin, un stade de rugby, celui du Stade Français. Juste en face du Parc des Princes, comme un symbole. Ou quand la folie des grandeurs du PSG toise le populaire Red Star.

« C’est un joli stade, mais ce n’est pas chez nous, résume Christian. Et puis quand tu joues devant 1 500 spectateurs, c’est triste. Heureusement, en tribune, on met un peu d’ambiance. Mais sinon, c’est pathétique. » Les ultras sont mis dehors. Sans repère. « C’est évident qu’on est perdus. L’an dernier, l’équipe s’entraînait à Saint-Leu. Cette année, c’est à Gennevilliers. L’an dernier, l’équipe jouait à Beauvais. Cette année, c’est à Jean-Bouin. On est où ? On est qui ? On va où ? » interroge Christian.
A cause de cette instabilité chronique, certains ultras ont lâché. Au moins provisoirement. Une grande majorité ne voulait pas se déplacer jusqu’à Beauvais. Une manière de contester, sans l’assumer pleinement. « Qui est venu à Beauvais ? Ce n’est pas compliqué : personne ou presque, lâche Christian, amer. Il y avait les vieux comme moi, parce qu’on ne voulait pas abandonner le Red Star. Mais on était une trentaine. »
Le club a bien tenté de mettre en place un car qui faisait le trajet depuis Bauer. Sans succès. « Au début, ils ont voulu ne prendre que les abonnés. Il y avait quatre personne, se rappelle Christian. Puis je leur ai expliqué qu’il serait judicieux de laisser monter tout le monde. Mais il n’a jamais été rempli. » Aujourd’hui encore, les ultras du Red ne déploient aucune bâche à Jean-Bouin. Ils les gardent pour les déplacements.
Au PSG aussi, certains ont fini par dire stop. Parce qu’ils n’avaient plus l’envie ni la force de se battre. Parce que tout est allé trop loin. Beaucoup trop loin. En mars 2010, Yann Lorence, un habitué du Kop Boulogne, trouve la mort dans une rixe entre supporters des tribunes Auteuil et Boulogne. Conséquence : le plan Leproux est mis en place par le président du PSG de l’époque – Robin Leproux – pour éjecter du Parc des Princes ces ultras ingérables.
Pendant plus de six ans, les ultras du PSG se sont donc battus. Mais cette fois pour revenir. Prouver qu’ils étaient capables de ne pas reproduire les erreurs du passé. Pendant longtemps, ils n’ont pas été entendus. « Le club était à 100 % contre nous, se remémore Romain Mabille. Alors on l’a mal vécu. Parce que nous, on voulait juste supporter notre club. »
Au Parc, les anciens abonnés d’Auteuil et de Boulogne étaient sur liste noire. Impossible d’entrer. A l’extérieur, ils n’étaient pas les bienvenus. Un jour de match à Toulouse, en 2013, ils se sont retrouvés bloqués plus de dix heures dans une déchetterie. Sans pouvoir assister au match.
Plus tard, pour des rencontres de Ligue des Champions, ils n’ont pu voir que l’extérieur de certains stades malgré des tickets valides achetés plus de 100 euros. « Quand on fait des milliers de kilomètres pour aller supporter notre équipe, c’est difficile à accepter, regrette Romain Mabille. A un moment donné, on se dit : “A quoi ça sert de continuer ? De toute façon on n’y arrivera jamais.” Heureusement, à Paris, on a notre caractère. On était convaincus de notre truc, alors on n’a rien lâché. Mais on se pose la question de savoir si ça va aboutir. »


Florian, un autre ultra de la tribune Auteuil, est plus compréhensif. Parce que lui-même a vu son comportement changer. « On nous en a tellement mis dans la gueule… Je ne peux pas vivre les matchs au Parc comme il y a dix ans. Ce n’est pas possible. Pas après ce qu’on nous a fait, la façon dont on nous a exclu. » Qu’importe que le club de la capitale soit devenu l’un des meilleurs d’Europe, Florian ne vibre pas davantage. Il en vient même à avouer, du bout des lèvres, qu’il préférait les années de galère, lorsque le PSG luttait pour sa survie en Ligue 1.
Les ultras sont peut-être maso. Romain Mabille, lui aussi, a du mal à mesurer son amour pour le club. « Je ne sais pas trop si je l’aime encore plus qu’avant. C’est difficile à dire tant on a dû affronter notre club pendant des années. » Il y a sans doute une part de fierté qui s’exprime.
Aimer – à la folie – sans retour est une souffrance. Mais les ultras parisiens garderont toujours cette flamme. Quoi qu’il arrive. « Je pense qu’être ultra, les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça représente tant qu’ils ne le vivent pas. Ce mouvement, ça nous tient à cœur. On l’a dans le sang. Alors oui, on m’a souvent reproché de faire passer le PSG avant tout le reste… (Il hésite) Mais c’est comme ça. C’est pas pour ça que ça changera. C’est non négociable. » On n’est pas ultra par hasard. Ni à Paris, ni ailleurs.
Ce long format a concouru à l’Equipe Explore












